
















 |
|
 |                |
 Consulter la version la plus récente.
Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Le transport maritime au Canada
2001 Le transport maritime au Canada - revue annuelle, 2001 Le fret manutentionné dans les ports et les terminaux maritimes du Canada a chuté en 2001 en raison d’un ralentissement de l’économie nord-américaine. L’économie canadienne a connu une croissance pour une dixième année consécutive, mais le taux de croissance du produit intérieur brut réel est passé de 5,3 % en 2000 à 1,9 % en 2001. Ce ralentissement a été accompagné d’un déclin du commerce de marchandises international, composante essentielle de la demande dans le secteur du transport maritime. Le commerce de marchandises effectué avec les États-Unis a diminué de 3 % pour s’établir à 607 milliards de dollars sur la base de la balance des paiements; cela est attribuable au repli de l’économie américaine et à une hausse de la sûreté à la frontière en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre. Le commerce de marchandises effectué avec d’autres pays que les États-Unis a diminué de 1 % pour se fixer à 161,6 milliards de dollars 1. En 2001, le tonnage total de fret manutentionné par les ports et les terminaux maritimes canadiens a diminué de 2,3 % par rapport à 2000, pour passer à 393,4 millions de tonnes (Mt). Le fret international (entre les ports canadiens et étrangers) a chuté de 2,3 %, passant de 293,8 Mt en 2000 à 286,9 Mt en 2001; le fret intérieur (entre deux ports canadiens) a diminué de 2,3 %, glissant de 109 Mt à 106,6 Mt. Soulignons que le fret intérieur est manutentionné deux fois par le réseau des ports et des terminaux canadiens, soit une fois au chargement et une fois au déchargement. La diminution du trafic international représente une déviation de la tendance observée au cours de la décennie s’échelonnant entre 1992 et 2001. S’établissant à 223,2 Mt en 1992, le trafic maritime international a augmenté de 28,5 % au cours de cette décennie et a connu une croissance à chacune des années antérieures à 2001, sauf en 1998, où on a observé une autre légère diminution par rapport à l’année record qu’a été 1997. Le trafic intérieur n’a augmenté que de 1,9 % au cours de la décennie. La tendance du trafic intérieur était à la baisse, passant de 104,5 Mt en 1992 à 93,4 Mt en 1997. Par la suite, le trafic a bondi pour atteindre un sommet de 109 Mt en 2000. Graphique 1
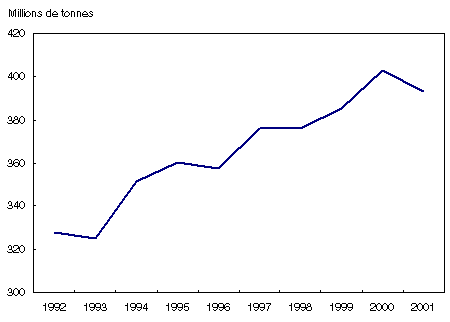
Graphique 2
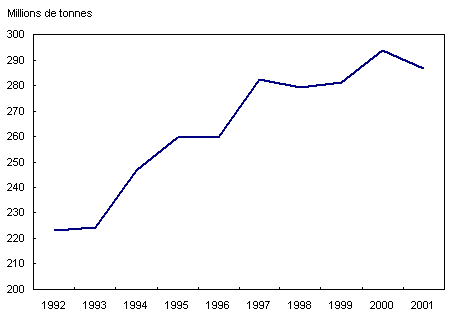
Graphique 3
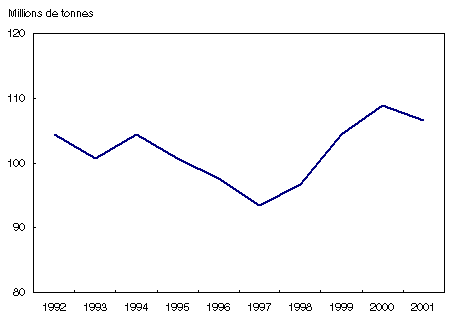
Fret maritime international Plus de 174,7 Mt de fret à destination de pays étrangers, dont les États-Unis, ont été chargées dans les ports et les terminaux maritimes canadiens en 2001, soit 13,1 Mt (7,0 %) de moins qu’en 2000. On a observé des déclins importants dans les livraisons de principales marchandises en vrac à destination des pays étrangers, particulièrement le minerai de fer, le charbon, le blé, le pétrole et le sable, les pierres et le gravier. Le personnel des ports et des terminaux maritimes du Canada a déchargé 112,1 Mt de fret international en 2001, soit 6.2 Mt (5,9 %) de plus qu’en 2000. Les livraisons de pétrole brut, de charbon, d’essence et de carburéacteur en provenance des pays étrangers expliquent la plus grande partie de cette augmentation. Fret acheminé entre le Canada et les États-Unis Le fret maritime du Canada à destination et en provenance des États-Unis a légèrement diminué (0,8 %), passant de 108,8 Mt en 2000 à 108 Mt en 2001. Cette diminution est attribuable au fret transporté aux États-Unis, qui a chuté de 4,2 % pour s’établir à 62 Mt. Le fret en provenance des États-Unis a augmenté de 4,2 %, passant à 45,9 Mt. Le déclin des expéditions du fret à destination des États-Unis est attribuable aux livraisons de minerai et de concentrés de fer, qui ont chuté de 9,6 Mt en 2000 à tout juste plus de 5 Mt en 2001. La plus grande partie du minerai de fer provenait du Labrador et était transporté à partir des ports du Bas Saint-Laurent, de Sept-Îles/Pointe-Noire et Port-Cartier. Le déclin a été accentué par les livraisons de pétrole brut aux États-Unis, qui ont chuté de 12,3 Mt en 2000 à 11 Mt en 2001 en raison du moins grand nombre de transbordements 2 du pétrole brut d’Hibernia via le port de Come-by-Chance. En outre, les livraisons de calcaire vers les États-Unis ont chuté de près d’un million de tonnes, passant de 2,4 Mt en 2002 à 1,5 Mt en 2001. Les ports de la côte du Pacifique, qui expédiaient presque 90 % du calcaire, ont été les principaux établissements touchés par ce déclin. Par contre, ces déclins ont été partiellement contrebalancés par les livraisons d’essence et de carburéacteur, lesquelles ont bondi de 63,1 % par rapport à 2000, pour s’établir à presque 7,7 Mt en 2001; il s’agit de livraisons records pour les ports des provinces maritimes, particulièrement les ports de Saint John et de Port Hawkesbury. Les livraisons de pierre, de sable, de gravier et de pierre concassée à destination des États-Unis ont augmenté de 19,7 % pour atteindre 7,9 Mt en 2001 et les livraisons de mazout ont aussi augmenté de 20,2 %, pour s’établir à 6,2 Mt. Les livraisons de charbon en provenance des États-Unis ont augmenté de 2 Mt par rapport à 2000, pour s’établir à 22,1 Mt en 2001. Cette hausse est principalement attribuable aux déchargements de charbon dans les ports des Grands Lacs de Nanticoke, de Courtright et de Port Credit. Il y a également eu des augmentations importantes dans les livraisons de mazout, de sel, d’essence, de carburéacteur et de pétrole brut en provenance des États-Unis, mais ces augmentations ont été contrebalancées par une diminution de 1,9 Mt des livraisons de minerai et de concentrés de fer en provenance des ports américains. En 2001, le personnel des ports canadiens a déchargé 4,5 Mt de minerai de fer provenant des États-Unis. Les ports de Sault-Ste-Marie et de Hamilton ont été les ports les plus touchés par ce déclin. Les navires immatriculés au Canada ont manutentionné 50,3 % du fret transporté entre le Canada et les États-Unis en 2001, ce qui représente une diminution par rapport aux 51,5 % de 2000. Les navires battant pavillon canadien ont été particulièrement dominants sur les Grands Lacs, transportant 87,5 % du fret échangé avec les ports des Grands Lacs situés aux États-Unis. Les navires battant pavillon américain ont transporté 9,9 % de tout le fret acheminé entre le Canada et les États-Unis, une augmentation par rapport aux 7,5 % enregistrés en 2000. En 2001, les navires battant pavillon étranger ont transporté le reste du fret acheminé entre le Canada et les États-Unis, soit 39,8 %. Fret acheminé entre le Canada et les pays d’outremer Le trafic maritime du Canada à destination et en provenance des ports d’outremer a glissé à 178,9 Mt en 2001, soit une diminution de 3,3 % par rapport à 2000. Le fret livré dans les ports d’outremer a diminué de 8,5 %, passant à 112,7 Mt, alors que le fret en provenance des ports d’outremer a augmenté de 7 % pour s’établir à 66,2 Mt. Les livraisons de minerai et de concentrés de fer canadiens vers l’Europe ont diminué de plus de 4 Mt, mais cette diminution a été contrebalancée par une hausse de 1,6 Mt des livraisons de minerai de fer vers les autres continents. Cette situation s’est traduite, en 2001, par des livraisons de minerai de fer totales de 17,6 Mt dans des ports d’outremer, comparativement aux 20,2 Mt de 2000. Les livraisons de charbon canadien dans les ports d’outremer ont chuté à 27,8 Mt en 2001, en raison d’une diminution de 3,2 Mt dans les livraisons à destination de l’Asie. Les livraisons de blé du Canada ont également chuté à 15,3 Mt en 2001 en raison d’une baisse de 1,7 Mt des livraisons de blé vers le Moyen-Orient et l’Afrique. Le pétrole brut, l’essence, le carburéacteur et le mazout sont les trois principales marchandises qui sont responsables de l’augmentation de 7 % du fret en provenance des ports d’outremer. La quantité de pétrole brut a augmenté à 31,5 Mt en 2001 grâce aux livraisons plus importantes en provenance de l’Europe et du Moyen-Orient. Les livraisons d’essence et de carburéacteur en provenance des ports d’outremer ont plus que doublé par rapport à 2000 et se sont établies à 2,8 Mt en 2001, grâce à un plus grand nombre de livraisons en provenance de l’Europe. La quantité de mazout en provenance des ports d’outremer a atteint 1,9 Mt en raison d’une augmentation des livraisons provenant de l’Amérique centrale et des Antilles. Les navires battant pavillon canadien ont manutentionné seulement 0,1 % du fret échangé avec les ports d’outremer en 2001, soit environ la même part qu’en 2000. Fret intérieur Les 106,6 Mt de fret intérieur manutentionné par les ports en 2001, qui représentaient la deuxième plus grande quantité enregistrée au cours de la dernière décennie, correspondaient à une diminution de 2,3 % par rapport à l’année record 2000. Le déclin du tonnage intérieur est principalement attribuable à un ralentissement dans le secteur forestier découlant du désaccord opposant le Canada et les États-Unis sur la question du bois d’oeuvre de résineux. En 2001, les ports du Canada ont manutentionné 19,7 Mt des livraisons intérieures de produits forestiers et ligneux, soit plus de 4,5 Mt de moins qu’en 2000. La diminution des livraisons intérieures de produits forestiers et ligneux a entraîné un déclin de 14,3 % du fret intérieur total manutentionné dans les ports du Pacifique en 2001. Ces derniers ont manutentionné 28,3 Mt du fret intérieur en 2001, soit 4,7 Mt de moins qu’en 2000. Les ports situés dans la région des Grands Lacs ont manutentionné 30,1 Mt de fret intérieur en 2001, soit 2,2 Mt de plus qu’en 2000, ce qui est principalement attribuable à l’augmentation du transport de charbon entre les ports des Grands Lacs. Les ports situés dans la région du Saint-Laurent ont manutentionné 25,6 Mt de fret intérieur en 2001, ce qui représente une diminution de 3,2 % par rapport à l’année précédente et s’explique principalement par une réduction des livraisons de minerai et de concentrés de fer et d’autres minéraux non métalliques entre les ports de la région. Le fret intérieur manutentionné par les ports de la région de l’Atlantique a augmenté de 4,4 % par rapport à 2000 et s’est établi à 22,3 en 2001. Cette augmentation est principalement attribuable au plus grand nombre de chargements de pétrole brut destinés aux ports de la région du Saint-Laurent. Trafic portuaire au Canada On a créé dix-neuf administrations portuaires canadiennes 3 (APC) en vertu de la Loi maritime du Canada de 1998 en se fondant sur leur potentiel d'autonomie financière. Les 19 APC ont géré 59,8 % du fret international total et 45,5 % du fret intérieur total que les ports et les terminaux maritimes canadiens ont manutentionné en 2001 4. Le fret international manutentionné par les APC a augmenté au cours de la dernière décennie, passant de 149,2 Mt en 1992 à 171,7 Mt en 2001. On a toutefois observé un important degré d’instabilité d’une année à l’autre, laquelle est attribuable aux produits en vrac, notamment le charbon et le blé. Le tonnage international a atteint un sommet de 184,3 Mt en 1997, année où les ports des APC ont manutentionné un record de 39,7 Mt de charbon, dont presque 90 % ont été exportées à partir des ports de Vancouver et de Prince Rupert, en Colombie-Britannique. Les exportations de charbon à partir de ces ports ont chuté de près de 20 % entre 1997 et 2001, car les dirigeants des aciéries de l’Asie ont trouvé des sources moins coûteuses et les mines de charbon du nord-est de la Colombie-Britannique se rapprochaient de la fin de leur vie économique. En outre, les livraisons internationales de blé dans les ports des APC ont grimpé en flèche en 1997, enregistrant leur troisième sommet de la décennie. Même si la tendance du transport de blé a été à la baisse au cours de la décennie, elle a cependant été instable, car la demande liée au blé et à la production agricole provenant du Canada a varié. Encore une fois, les ports de Vancouver et de Prince Rupert ont été les plus touchés, étant les principaux ports exportateurs de blé et manutentionnant en moyenne 76 % du tonnage annuel des mouvements de cette marchandise. Le fret conteneurisé, qui comprend généralement des biens de consommation et des produits de plus grande valeur, a figuré parmi les secteurs ayant connu la plus forte croissance sur le plan du trafic international géré par les APC. Le poids du fret transporté par conteneur a presque doublé au cours de la décennie, passant de 12,5 Mt en 1992 à 23,4 Mt en 2001. La grande partie de ce fret a été manutentionnée par les ports de Vancouver, de Montréal et de Halifax. Graphique 4
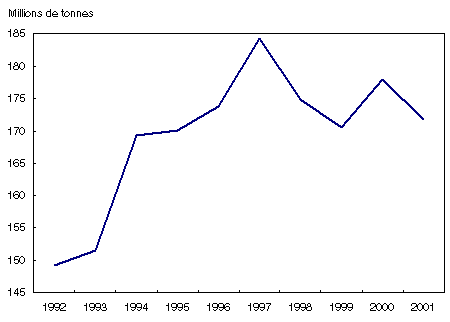
Graphique 5
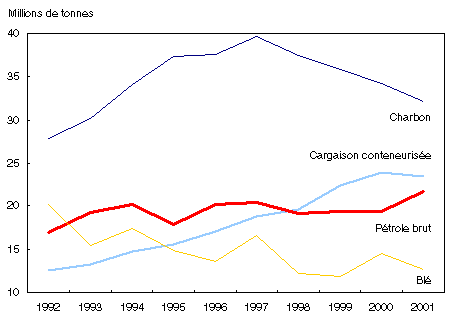
Le fret international manutentionné dans les ports et les terminaux ne relevant pas des APC a augmenté de 55,7 %, passant de 74 Mt en 1992 à 115,2 Mt en 2001. Cette croissance rapide est attribuable aux éléments suivants : les transbordements de pétrole brut de la mer du Nord par l’intermédiaire d’un port de l’Atlantique vers le littoral est des États-Unis, l’augmentation des importations de charbon des États-Unis destiné à la production d’électricité dans une installation des Grands Lacs, et les exportations de pétrole brut provenant des puits sous-marins et des ports sur la côte est. Graphique 6
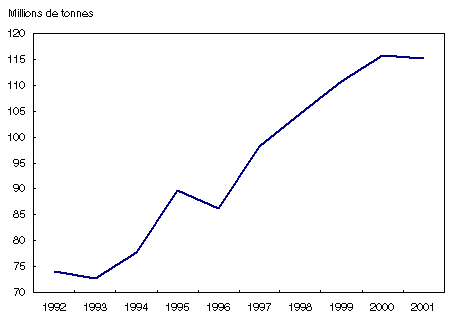
Le fret intérieur manutentionné par les 19 APC est demeuré plutôt stable au cours de la dernière décennie, n’accusant qu’une légère baisse de 50,6 Mt en 1992 à 48,5 Mt en 2001. Cette diminution était la plus marquée dans le cas des livraisons de blé et des produits du pétrole (mazout, essence et carburéacteur). De façon générale, les livraisons de blé intérieures effectuées dans les ports des APC ont diminué au cours de la décennie, passant de 9,7 Mt en 1992 à 5,5 Mt en 2001, à l’exception d’une montée en flèche en 1997, où le nombre des livraisons a atteint 10 Mt. Les ports de Thunder Bay et de Québec ont été les principaux ports des APC. Le fret combiné du mazout, de l’essence et du carburéacteur manutentionné dans les ports des APC a chuté de 10,7 Mt en 1992 à 7,8 Mt en 2001 en raison de la rationalisation de petites raffineries à Vancouver, à Montréal et à Halifax, ainsi qu’à un changement de mode de transport (adoption du transport ferroviaire) pour ces produits dans le corridor Québec-Montréal. Les déclins associés à ces marchandises ont été partiellement contrebalancés par l’augmentation des livraisons intérieures de copeaux, de calcaire, de pierre, de sable, de gravier et de pierre concassée. Graphique 7
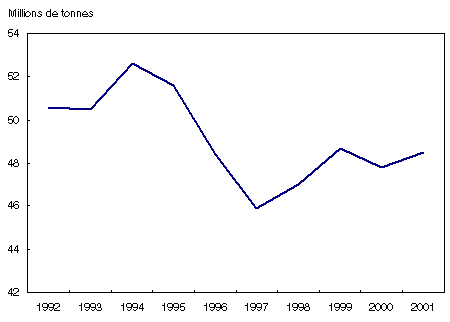
Contrairement à la baisse observée sur le plan du trafic intérieur dans les APC, les ports et les terminaux ne relevant pas des APC ont connu une augmentation de 7,7 % de la manutention du fret intérieur au cours de la décennie. Le fret est passé de 53,9 Mt en 2000 à 58,1 Mt en 2001. Cette situation est principalement attribuable aux livraisons intérieures de pétrole brut, qui ont augmenté considérablement au quatrième trimestre de 1998 en raison du début de la production au large de la côte de Terre-Neuve. En 2001, les ports ne relevant pas des APC ont manutentionné 10 Mt de pétrole brut comparativement à seulement 70 mille tonnes en 1992. Cette hausse a été partiellement contrebalancée par la diminution des livraisons intérieures de rondins et d’autres bois bruts et de charbon dans les ports ne relevant pas des APC. Graphique 8
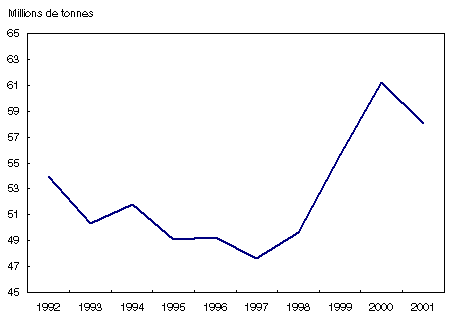
Le port de Vancouver a manutentionné 72 Mt de fret maritime en 2001, ce qui représente une diminution de 4,4 % par rapport à l’année record 2000, laquelle s’explique par une baisse du fret international à destination d’autres pays. Le port de Vancouver est demeuré le port canadien dominant en ce qui concerne le fret en vrac et les marchandises conteneurisées, manutentionnant 18,3 % du fret maritime au Canada en 2001. Quatre marchandises en vrac ont constitué près de 60 % du tonnage total traité à Vancouver, soit le charbon (26,5 Mt), le blé (7,3 Mt), le soufre (5,2 Mt) et la potasse (3,2 Mt). Les quatre produits étaient presque exclusivement destinés à l’exportation et ils ont tous connu une baisse comparativement à 2000. Les livraisons de charbon ont diminué de 1,7 % en raison du déclin de la demande de charbon canadien en Asie et n’ont été que partiellement contrebalancées par une plus grande demande en Europe. La quantité de blé manutentionnée par les ports a également diminué de 1,1 Mt (12,9 %) comparativement à 2000 en raison d’une mauvaise récolte dans les Prairies au cours de l’été précédent et du recul des livraisons au Moyen-Orient, particulièrement en Iran et en Iraq. Bien que les livraisons de soufre vers la République populaire de Chine aient continué d’augmenter, les livraisons totales de soufre ont chuté de 3,2 % en raison d’une diminution des livraisons vers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. La diminution des livraisons de potasse canadienne vers la République populaire de Chine s’est traduite par une baisse de 16 % des livraisons de potasse comparativement à 2000. Le nombre des conteneurs internationaux manutentionnés à Vancouver a chuté de 1,7 % comparativement à son niveau record de 2000, passant à 1,1 million de conteneurs équivalents vingt pieds (EVP) en 2001, ce qui représente 43 % des conteneurs manutentionnés dans les ports canadiens. Le poids du fret transporté dans plus de 90 % de ces conteneurs a atteint 10,1 Mt, soit une légère augmentation (0,9 %) par rapport à 2000. Le tonnage du fret conteneurisé en provenance des ports étrangers a augmenté de 5,8 % pour s’établir à 3,5 Mt, en raison de la demande nord-américaine toujours solide à l’égard des biens de consommation provenant d’Asie. Quant au fret conteneurisé à destination d’autres pays, il a diminué de 1,5 % pour se fixer à 6,5 Mt, ce qui s’explique par une baisse des livraisons conteneurisées de bois d’oeuvre, de papier journal et d’autres produits ligneux vers l’Asie. Le port de Sept-Îles (y compris Pointe-Noire) a manutentionné 20,8 Mt de fret en 2001, ce qui représente une baisse de 10,7 % par rapport à 2000. Le fret international manutentionné dans ce port a chuté de 19,2 % par rapport à 2000 et est passé à 15,4 Mt en 2001. Cette diminution est principalement attribuable aux livraisons moins importantes de minerai et de concentrés de fer vers les États-Unis (en baisse de 40,2 % et s’établissant à 4,3 Mt) et vers l’Europe (en baisse de 14,4 % et s’établissant à 6,4 Mt). Le fret intérieur manutentionné à Sept-Îles/Pointe-Noire a augmenté de 26,9 % et est passé à 5,5 Mt, ce qui s’explique principalement par une hausse de 42,2 % des livraisons intérieures de minerai de fer vers Hamilton et Nanticoke. Le port de Montréal (y compris Contrecoeur) a manutentionné 18,9 Mt de fret en 2001, soit une diminution de 5,8 % par rapport à 2000, principalement attribuable à une baisse des déchargements de minerai et de concentrés de fer, de fer et d’acier, d’autres produits chimiques de base et d’autres minéraux non métalliques. Le nombre de conteneurs internationaux manutentionnés dans le port a diminué en 2001, passant à 919 257 EVP, et le poids du fret dans ces conteneurs a chuté de 5,4 % pour s’établir à 8,4 Mt. Malgré la diminution du tonnage conteneurisé, le port de Montréal est demeuré le port de transbordement le plus important en Amérique du Nord pour le fret conteneurisé européen, manutentionnant 8 Mt de ce fret en 2001. (Le port de New York/New Jersey arrivait au deuxième rang, manutentionnant 7,9 millions de tonnes de fret conteneurisé européen en 2001, selon des données fournies par l’administration maritime du ministère des Transports des États-Unis 5). Le tonnage total manutentionné par le port de Saint John, au Nouveau-Brunswick, a augmenté de 27,1 % par rapport à 2000 pour se fixer à 24,5 Mt en 2001. Trois marchandises, à savoir le pétrole brut, le mazout et l’essence et le carburéacteur, représentaient presque 90 % du tonnage manutentionné dans le port et expliquent principalement l’augmentation enregistrée. Les livraisons de pétrole brut ont augmenté de 21,7 % pour s’établir à 10,8 Mt en 2001; presque 97 % du pétrole brut déchargé provenait de ports étrangers. Les livraisons de mazout, en hausse de 33,1 %, sont passées à 6 Mt, dont 81,9 % ont été expédiées vers des ports étrangers. Les livraisons d’essence et de carburéacteur ont augmenté de 55 % pour s’établir à 4,9 Mt, dont 87,6 % ont été expédiées vers des ports étrangers. Soixante-quinze pour cent du pétrole brut importé provenait de la mer du Nord et le reste provenait de l’Arabie saoudite, alors que 96 % des produits de pétrole brut à destination de pays étrangers ont été expédiés dans des ports de la côte atlantique des États-Unis et de la côte du Golfe. Le port de Saint John a manutentionné 298,9 kilotonnes (Kt) de fret international conteneurisé en 2001, soit une baisse de 6 % par rapport à 2000. Le fret total manutentionné au port de Québec (y compris Lévis) a chuté de 3,1 % par rapport à 2000 et s’est établi à 15,2 Mt en 2001. Le fret international, qui représentait presque 79 % du fret total, a diminué de 9,8 %, passant à 11,9 Mt. La baisse du fret international est principalement attribuable à une diminution des transbordements de minerai et de concentrés de fer en provenance de l’Australie et de l’Amérique du Sud via Québec vers les Grands Lacs en territoire américain et à un déclin des livraisons de pétrole brut à destination du Canada. Le port a manutentionné 3,2 Mt de fret intérieur en 2001, soit une augmentation de 33,2 % par rapport à 2000 en raison des déchargements de pétrole brut provenant du Canada atlantique. Dans le port de Halifax, le tonnage total manutentionné a augmenté de 1,3 % par rapport à 2000, s’établissant à 13,9 Mt en 2001. Le fret international, qui représentait 80,6 % du fret total, a connu une hausse de 2,1 % par rapport à 2000 et a atteint 11,2 Mt. L’augmentation est principalement attribuable aux livraisons de pétrole brut en provenance du Venezuela. Le port de Halifax a manutentionné 4,2 Mt de fret international conteneurisé en 2001, soit un peu moins (0,8 %) que la quantité record manutentionnée en 2000. Le port de Hamilton a manutentionné 10,6 Mt de fret maritime en 2001, ce qui représente une baisse de 10,2 % par rapport à 2000. Cette baisse est entièrement attribuable à la diminution de 23,3 % du trafic international, à 4,3 Mt. Cette diminution s’explique principalement par le moins grand nombre de livraisons de minerai et de concentrés de fer provenant des États-Unis et de fer et d’acier provenant d’Asie et d’Europe. Le trafic intérieur a augmenté de 1,9 % pour s’établir à 6,3 Mt en 2000 en raison d’un augmentation des déchargements de minerai et de concentrés de fer au Canada même. Le port du fleuve Fraser a manutentionné 11,5 Mt de fret maritime en 2001; il s’agit d’une hausse de 4,5 % par rapport à 2000. Le fret intérieur représentait 7.9 Mt ou 68,9 % du tonnage total manutentionné dans le port. Le plus grand nombre de livraisons de calcaire a entraîné une augmentation de 6,3 % du trafic intérieur. Le port a manutentionné une quantité record de 3,6 Mt de fret international, soit une légère augmentation (0,8 %) par rapport à 2000, l’année record précédente. Le port du fleuve Fraser est demeuré le quatrième plus important port de conteneurs au Canada, manutentionnant 476,6 kilotonnes et 49 197 EVP de fret international conteneurisé. Une augmentation marquée des livraisons de charbon à l’échelle nationale et internationale a aidé l’Administration portuaire de Thunder Bay à réaliser un gain de 3,2 % sur le plan de la manutention du fret maritime en 2001. Le tonnage total manutentionné a été de 9,1 Mt en 2001, comparativement à 8,8 Mt en 2000. Les livraisons de blé ont légèrement diminué (4,4 %) par rapport aux niveaux de 2000 et ont représenté 4,7 Mt manutentionnées. Les livraisons de blé représentent 52 % de tout le fret manutentionné dans le port. Les livraisons de charbon ont rebondi, passant d’un creux de 563 kilotonnes en 2000 aux 1 501 kilotonnes expédiées du port en 2001. Les livraisons de charbon au pays représentaient 69 % de ce total et étaient destinées aux port de Courtright, de Hamilton, de Sault-Sainte-Marie et de Nanticoke. Le fret total manutentionné à Prince Rupert a chuté de 34,7 %, passant de 7,2 Mt en 2000 à 4,7 Mt en 2001. À la suite de la fermeture d’une mine de charbon en Colombie-Britannique en septembre 2000, les livraisons de charbon vers des pays étrangers par le biais du terminal ont diminué de 53 %, passant de 3,5 Mt en 2000 à 1,6 Mt en 2001. Le blé, principal fret manutentionné, a accusé une baisse de 2 Mt, soit 18,9 % de moins que les 2,5 Mt manutentionnées en 2000. Les produits forestiers et ligneux manutentionnés ont également chuté de 27,1 %, glissant de 569 kilotonnes en 2000 à 415 kilotonnes en 2001. Plus de 95 % du fret manutentionné par l’Administration portuaire de Prince Rupert est destiné aux ports étrangers. Le port de Windsor (Ontario) a manutentionné 4,7 Mt de fret maritime en 2001, soit une baisse de 12,1 % par rapport à 2000, ce qui marque la troisième année consécutive de la réduction du trafic. Tant le secteur intérieur qu’international ont été touchés. Le fret international de fer et d’acier – primaires et semi-finis – a diminué de 85,6 % par rapport à 2000. L’année dernière, le port a manutentionné 445 kilotonnes, ce qui représente 15 % du fret international total manutentionné, comparativement à seulement 64 kilotonnes en 2001, avec une part de 2 %. Pour contrebalancer partiellement cette baisse, on a enregistré des gains sur le plan des produits agricoles et alimentaires (27,7 %), du mazout et des produits chimiques de base (38,4 %) et des minéraux (5,9 %). Sur le marché intérieur, les livraisons moins importantes de produits agricoles et alimentaires et de minéraux se sont traduites par une diminution du fret manutentionné, qui est passé de 2,5 Mt en 2000 à 2,1 Mt en 2001. Le tonnage total signalé pour le port de North Fraser a diminué de 13,5 % par rapport à 2000 pour atteindre 3,6 Mt en 2001, et la totalité de ce tonnage était liée au trafic intérieur. Les trois principales marchandises manutentionnées dans le port étaient les copeaux de bois (1,4 Mt), les rondins et autres bois bruts (1,1 Mt) et la pierre, le sable, le gravier et la pierre concassée (872 kilotonnes). Le port de North Fraser est le port principal en ce qui a trait au trafic de remorqueurs et de barges et l'utilisation d'estacades flottantes sur la côte du Pacifique. Une partie du fret lié à ce trafic est chargée et déchargée dans le port tandis qu'une autre partie est transportée à partir du port jusqu'à d'autres points du fleuve Fraser. On relève d'importantes différences entre les statistiques transmises par l'Administration portuaire de North Fraser et celles qui sont fournies dans la présente publication 6. Le port de Trois-Rivières a manutentionné 2,4 Mt de fret maritime en 2001, soit une hausse de 5,5 % par rapport à 2000. Le fret intérieur, qui représentait 22 % du fret total, a augmenté de 12,1 %, passant de 484 kilotonnes à 543 kilotonnes. Les livraisons plus importantes de mazout, d’essence et de carburéacteur, combinées à la livraison de sel à Trois-Rivières, ont permis de réaliser ce gain. Le fret international manutentionné a augmenté de 3,8 % en 2001 pour se fixer à 1,9 Mt. L’alumine (543 kilotonnes), d’autres minéraux non métalliques (252 kilotonnes) et le blé (245 kilotonnes) ont été les principaux groupes de produits ayant contribué à l’augmentation du fret étranger manutentionné en 2001. Le port de Nanaimo a manutentionné 2,2 Mt de fret maritime au total en 2001, ce qui représente une hausse de 12,3 % par rapport à 2000, le fret intérieur et le fret international ayant tous deux augmenté. Le fret intérieur total manutentionné a augmenté de 2,8 % pour atteindre 1 192 kilotonnes tandis que le fret international manutentionné a connu une hausse de 26,1 % pour s'établir à 993 kilotonnes. Les produits forestiers et ligneux ont représenté 75 % de toutes les livraisons et les produits de pâtes et papiers ont constitué un autre 15 % du fret total manutentionné en 2001. Le fret total manutentionné par le port de Belledune a augmenté de 20,7 % par rapport à 2000 pour atteindre 2 Mt en 2001. Cette augmentation est principalement attribuable aux plus importantes livraisons de charbon, de mazout et de produits chimiques de base en provenance des régions de la côte de l’atlantique et des Grands Lacs des États-Unis, ainsi qu’aux plus importantes livraisons de produits minéraux vers des destinations européennes. Le port a manutentionné 2 Mt de fret international et 247 kilotonnes de fret intérieur. Le port de Toronto a manutentionné 1,8 Mt de fret maritime en 2001, soit 4,2 % de plus que les niveaux d’activité de 2000. Le sel, le sucre et le ciment ont constitué plus de 87 % du fret manutentionné à Toronto. L’activité intérieure a représenté 962 kilotonnes comparativement aux 839 kilotonnes de fret étranger manutentionné en 2001. La portion des Grands Lacs située aux États-Unis, l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale ont été les régions étrangères dominantes vers lesquelles étaient expédiés les produits transitant par les installations portuaires de Toronto. Le port de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, a manutentionné 1,3 Mt de fret maritime en 2001, ce qui représente une augmentation de 25,8 % par rapport à 2000. La grande partie de cette augmentation peut être attribuable à la croissance de l’activité d’approvisionnement en haute mer. Près de 97 % du fret total ou 1,2 Mt étaient constitués de fret intérieur, dont les principales composantes étaient les livraisons de produits manufacturés et divers (445 kilotonnes) provenant de Montréal et de Halifax et le mazout et les produits chimiques de base (363 kilotonnes) en provenance de Saint John et de Halifax. Le port du Saguenay (Chicoutimi) a manutentionné 411 kilotonnes de fret maritime en 2001, comparativement à 414 kilotonnes en 2000. Le fret international représentait plus de 80 % de l’activité portuaire. En 2001, le port du Saguenay a manutentionné 313 kilotonnes de fret international, soit une baisse de 1,3 % par rapport à l’année précédente. Le port a manutentionné un moins grand nombre de livraisons à l’étranger de produits forestiers et ligneux, de produits métalliques et ouvrés, de machinerie et d’équipement de transport durant l’année; les livraisons à l’étranger de produits de pâtes et papiers, de charbon, de mazout et de produits chimiques de base ont augmenté. Le tonnage intérieur a légèrement augmenté, soit de 2 %, pour s’établir à 79,9 kilotonnes en raison du plus grand nombre de livraisons de sel. Le port de Port Alberni a manutentionné 330 kilotonnes de fret en 2001, ce qui représente une baisse de 62 % comparativement aux 874 kilotonnes manutentionnées en 2000. La manutention de fret intérieur est passée de 683 kilotonnes à 217 kilotonnes et la manutention de fret international a chuté, glissant de 191 kilotonnes à 114 kilotonnes. Les produits forestiers et ligneux ont été la seule catégorie de produits en 2001 et comprennent les livraisons de bois d’oeuvre, de rondins et d’autres bois bruts. |
|
|
|