Étude spéciale
Revue de la croissance économique du Canada
par Philip Cross *
Introduction
L’année 2004 a été la meilleure en 27 ans pour la croissance de l’économie mondiale avec un taux de progression de 5,1 % selon le FMI. Le moteur en a été une croissance vive et soutenue aux États-Unis et en Chine. Les États-Unis ont aisément dominé à un tableau de la croissance économique qui est commun à tous les pays membres du Groupe des Sept. Son PIB réel s’est élevé de 4,4 % à l’encontre même des inquiétudes manifestées un peu partout au sujet de la durabilité de la croissance d’une économie américaine devant faire face à des cours pétroliers records et à des déficits commerciaux. Ce sont des craintes qui ont trouvé leur expression (sans fondement) dans l’enlisement une année durant de l’indicateur avancé aux États-Unis. Le Royaume-Uni a suivi les États-Unis avec un taux de progression de 3 % de son économie, devançant tout juste le Canada qui devançait un peu à son tour le Japon (mais son PIB s’est contracté au second semestre). L’Europe continentale était toujours à la traîne avec des gains de moins de 2 %, néanmoins supérieurs à ses taux négligeables de croissance de 2003.
Les événements mondiaux sont demeurés le moteur de l’évolution d’une économie canadienne d’une valeur de 1,3 billion. Notre dollar a gagné encore 5 cents en moyenne sur le dollar américain après une hausse de 7 cents l’année précédente. Ce sont là les augmentations consécutives les plus imposantes jamais relevées pour le taux de change canado-américain, le dollar de notre voisin du sud étant en dévalorisation par rapport à la plupart des grandes monnaies au sein de l’OCDE. Les cours des produits de base ont offert leurs meilleurs gains d’affilée depuis les premières années de la décennie 1970, ce qui s’explique en partie par le mouvement en cours d’intégration rapide de la Chine à l’économie mondiale.
La montée de la demande à l’exportation est à l’origine de toute l’accélération de la croissance du PIB canadien, dont le taux de progression est passé de 1,7 % en 2003 à 2,8 % en 2004. Le taux d’accroissement de la demande intérieure finale a été à peu près stable à 3,8 % grâce à l’affermissement des investissements des entreprises. L’accumulation de stocks a été un peu plus rapide; elle a eu lieu en majeure partie après l’affaissement de la demande en fabrication au second semestre. Signalons que les agriculteurs ont dû garder leurs bovins, puisque la frontière américaine restait fermée à nos exportations de viande de bœuf.
Selon diverses mesures, l’économie canadienne aurait eu une meilleure performance que ne semble l’indiquer l’emploi ou le PIB en volume. L’accroissement de notre pouvoir d’achat déterminé par le renchérissement des produits de base a contribué à faire monter le PIB de 4,7 % en base « commandes » (ce qui rend compte de termes de l’échange plus favorables pour le Canada) après une hausse de 4,5 % en 20031. C’est près du double de la croissance du PIB proprement dit dans cette période. De même, notre patrimoine national s’est enrichi en moyenne de 6,3 % en valeur nette à cause de la valorisation du sol comme ressource et de la montée des prix de l’habitation. Et la croissance du PNB a dépassé le PIB. L’essor des marchés de l’habitation et des produits de base à l’échelle du pays devait également mener à une répartition régionale et rurale-urbaine plus égale de la croissance2.
Figure 1

Plusieurs autres tendances à long terme n’ont pas discontinué. Malgré le renchérissement des produits de base, les taux d’inflation et d’intérêt sont demeurés à de bas niveaux historiques. De plus, les tendances sectorielles des prêts et des emprunts sont restées les mêmes avec des excédents immenses pour les entreprises et appréciables pour les administrations publiques et un excédent record au compte courant. Les ménages se sont endettés davantage pour financer leur engouement pour l’habitation, enhardis dans cette entreprise par une valeur nette de l’habitation en progression en raison de la fermeté des prix des maisons et des cours boursiers. Enfin, le vieillissement inévitable de la population a continué à modifier le profil démographique canadien.
Figure 2

Le huard en plein essor
La montée des cours du change a une fois de plus été l’événement économique de l’année, mais les conséquences ont été moins fâcheuses qu’en 2003. Non seulement le dollar canadien a moins augmenté qu’en 2003, mais sa valorisation a été concentrée au dernier semestre (en 2003, la remontée initiale avait fait sentir ses effets tout au long de l’année). Le résultat partiel en a été que le bond du dollar l’an dernier n’a pas empêché les exportations de secouer une léthargie qui avait duré trois ans.
L’inflation du taux de change canado-américain a amélioré les termes de l’échange au Canada. Contrairement à ce qui s’est passé en 2003, ce n’est pas seulement que les prix aient baissé à l’importation (leur taux de décroissance étant tombé de -7 % à -2 %). L’an dernier, les prix ont un peu monté à l’exportation, le renchérissement des produits de base ayant eu plus de poids que l’effet d’amortissement de la valorisation du dollar (plus particulièrement dans le cas des produits dont le prix est exprimé en dollars américains). Le moteur de cette évolution a été une croissance plus rapide en Chine. La vorace demande chinoise qui s’attache aux ressources naturelles a eu pour effet direct de multiplier les exportations canadiennes et indirect de pousser les prix en hausse pour les marchandises expédiées ailleurs dans le monde.
Figure 3

La valorisation du dollar a également influé sur les flux d’investissements directs. Avec un pouvoir d’achat supérieur du dollar canadien à l’étranger et plus particulièrement aux États-Unis, les Canadiens ont pu plus facilement investir dans les autres pays. Les investissements directs à l’étranger ont progressé l’an dernier à une valeur de 57 milliards (tout près du record de 2000) à la suite du 30 milliards en 2003. Il y a eu surtout des prises de contrôle de sociétés américaines dans les domaines des finances et de l’énergie.
En revanche, la hausse du taux de change a fait que l’étranger a dû payer plus cher pour investir au pays. Après s’être établis en moyenne à près de 50 milliards de 1998 à 2002 à une époque de dévalorisation du dollar, les investissements directs au Canada ont ralenti à moins de 10 milliards en valeur annuelle ces deux dernières années, le plus bas niveau depuis 1993.
Figure 4

Cette valorisation a aussi incité les Canadiens à faire un nombre record de voyages à l’étranger, vers l’outre-mer en particulier, mais sans pour autant dissuader les voyageurs en provenance d’étranger de se rendre chez nous. Ceux-ci sont bel et bien revenus après une accalmie provoquée par l’épidémie de SRAS en 20033.
Commerce extérieur
L’an dernier, notre excédent au compte courant a pris une valeur record de 33,8 milliards. Une reprise dans le cas des revenus tirés des exportations devait porter l’excédent au compte des biens à un sommet en trois ans de 67 milliards. Ce meilleur rendement à l’exportation, nous le devons à la croissance de nos exportations vers la Chine. Celles-ci se sont élevées de 39 % après avoir augmenté de 15 % en 2003. Le gros de cette évolution a eu lieu dans les ressources naturelles hors énergie qui forment environ 80 % de nos livraisons à la Chine (et représentent plus de la moitié de la progression de ces exportations l’an dernier). Les exportations de produits manufacturés vers les États-Unis se sont également accrues au premier semestre avant que la valorisation du dollar n’en ralentisse le rythme au second. Il reste que nos livraisons d’énergie à notre voisin du sud ont été fermes toute l’année.
Dans l’ensemble, les exportations ont progressé de 5 % en volume après avoir baissé de 4 % depuis 2000. La croissance a été étalée sur tous les secteurs avec une valeur approximative de 7 % sauf pour les produits énergétiques et les biens de consommation avec de faibles valeurs. La montée des prix s’est traduite par une progression à deux chiffres des revenus tirés des exportations de produits énergétiques, forestiers et métalliques. Les prix ont baissé pour des produits manufacturés comme les automobiles et les machines et le matériel (la valorisation du dollar a retranché 4 % aux prix dans l’industrie depuis deux ans).
En 2004, les importations se sont accrues de 6 %; c’est plus que le sommet atteint en 2000. Tout le gain est en volume. Les importations en provenance de la Chine ont fait un nouveau bond de 30 %. Elles ont doublé ces trois dernières années. Les importations en provenance de tous les autres pays plafonnent depuis 2001. Les machines et le matériel ont dominé à l’importation avec une hausse de 13 %, suivis de près de l’énergie et des biens de consommation.
Figure 5

Par ailleurs, le déficit au compte du revenu de placements a baissé de plus de 1 milliard en grande partie parce que la valorisation du dollar a facilité le service de la dette extérieure de notre pays. Disons enfin que les bénéfices tirés de nos investissements passés à l’étranger ont été soutenus par une économie mondiale qui bat son plein.
Des exportations d’énergie en plein essor
Des cours énergétiques en progression et un prix du pétrole franchissant pour la première fois la barre des 50 dollars américains le baril ont rivalisé avec la montée du dollar pour constituer l’événement économique le plus important de l’année. L’énergie a renforcé sa position de première ressource canadienne à l’exportation. Les cours des hydrocarbures ayant plafonné à l’occasion de la crise asiatique de 1998, la part de l’énergie dans la masse de nos exportations a plu que doublé, passant de 7,3 % à 16,1 %4. Cette progression s’est opérée en majeure partie au détriment de la part des automobiles et des machines et du matériel qui, dans tous les cas, ont subi des pertes de plus de trois points (chaque point équivaut à plus de 4 milliards. Le secteur des biens de consommation est le seul autre à avoir affiché ne serait-ce qu’une modeste augmentation. Les autres ressources naturelles ont vu leur part des exportations diminuer légèrement.
Figure 6

L’excédent commercial du Canada au compte de l’énergie est aujourd’hui presque aussi important que celui de tous les autres comptes de ressources à l’exportation (ce qui comprend les exportations de produits forestiers – la première de nos exportations pendant longtemps –, alimentaires et métalliques). Nos exportations d’énergie ont doublé depuis 1999, entraînées à la hausse par l’augmentation des prix et les nouvelles sources d’approvisionnement énergétique.
Cette dépendance à l’égard de l’énergie pour une si grande partie de nos exportations nous amène peut-être à nous interroger sur notre vulnérabilité devant un affaissement des prix comme dans le secteur pétrolier en 1986, 1991 et 1998. L’OCDE a cependant fait remarquer que les marchés prévoient que « les prix du pétrole seront durablement plus élevés »5. Les cours à long terme (horizon de jusqu’à 7 ans) sont montés à près de 40 $ le baril, alors qu’ils étaient stables à 20 $ malgré d’amples variations des cours au comptant dans les années 1990.
Le Canada est bien placé pour tirer parti de l’essor des cours énergétiques. Ces dix dernières années, les entreprises ont consenti le tiers de leurs investissements dans le secteur de l’énergie, enrichissant leur stock de capital brut de 218 milliards depuis 1994. Plus de la moitié de cette progression a eu lieu dans le secteur pétrolier et gazier avec entre autres des mégaprojets comme ceux d’Hibernia, de Terra Nova et de l’île de Sable au large du littoral atlantique, de Ladyfern en Colombie-Britannique et plus particulièrement, des exploitations de sables pétrolifères en Alberta. Bien sûr, tous ces projets demandaient que l’on accroisse nettement les capacités d’acheminement par pipeline. Si les revenus tirés de l’énergie par le Canada ont été en progression soutenue ces dernières années, c’est en partie à cause des retombées de ces investissements énormes et souvent hasardeux.
Figure 7

Les investissements d’énergie se font à une échelle telle que toutes les autres industries sont laissées dans l’ombre. Pour l’accroissement du stock de capital, c’est l’industrie financière qui se classe au deuxième rang depuis 1994 avec un gain de 56 milliards (dont 30 milliards dans les trois ans ayant précédé la conversion informatique du passage au nouveau millénaire). Dans les télécommunications et le commerce de détail, le stock de capital a respectivement augmenté de 40 et 25 milliards. Suivent le transport aérien avec 21 milliards et l’industrie de l’automobile avec 11. Il reste que, depuis dix ans, les investissements qui ont eu lieu dans toutes ces industries confondues n’ont pas égalé les investissements dans le secteur de l’énergie.
Figure 8
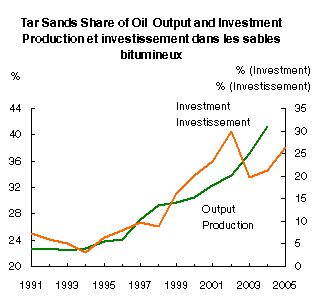
Depuis 1994, les formes classiques de pétrole et de gaz sont devancées par les formes non classiques (sables bitumineux) pour la croissance des investissements. Dans ce dernier secteur, les investissements ont monté de 400 millions (moins de 4 % des investissements dans le secteur classique) à 8,5 milliards cette année (26 % des investissements dans ce même secteur classique). La part de la production pétrolière que détiennent les exploitations de sables pétrolifères s’est élevée à 41 %, suivant de près sa part de tous les investissements pétroliers et gaziers par le caractère hautement capitalistique de la production non classique. Des investissements de taille au début du nouveau millénaire ont été suivis d’un essor de la production de bitumineux à compter de 2002 et les nouvelles dépenses en immobilisations sont en voie de se multiplier en vue de relèvements de la production plus loin dans la décennie.
Figure 9

La mise en valeur des sables pétrolifères est l’inévitable conséquence de la décroissance des réserves de pétrole classique, et ce, même après la découverte de nouveaux gisements de pétrole au large des côtes. Aujourd’hui, les réserves sous forme de sables bitumineux sont quadruples des réserves de pétrole classique.
Garants du futur approvisionnement énergétique, les sables pétrolifères sont d’un rendement énergétique inférieur à l’extraction, et il pourrait s’ensuivre une augmentation des gaz à effet de serre. Il a fallu 4 % du gaz naturel de l’Ouest canadien en 2001 pour extraire le pétrole des sables et produire la vapeur nécessaire à la production in situ6.
La concentration de la croissance dans les ressources à forte utilisation de capital contribue aussi à expliquer la croissance des profits par rapport aux salaires et traitements ces dernières années. La part du revenu du travail a baissé à moins de la moitié du PIB (49,4 %) l’en 2004 pour la première fois.
Des investissements des entreprises en renforcement
Les investissements des entreprises se sont mis peu à peu à se rétablir d’une situation de surinvestissement en TIC au début du millénaire. Ils sont revenus à leur sommet atteint en 2001. Après avoir reculé les trois années précédentes, les entreprises ont investi 6 % de plus l’an dernier et prévoient accroître encore les immobilisations de 8 % en 2005.
Presque tout le surcroît d’investissement en 2004 est allé aux machines et au matériel. Les ordinateurs sont demeurés en vogue. Pour la machinerie industrielle, la croissance a été soutenue à environ 10 %, les fabricants tâchant d’élever leur productivité. Même les dépenses en appareils de télécommunication se sont tirées d’un marasme ayant duré trois ans.
Les dépenses de construction des entreprises étaient toujours partagées entre des gains pour les travaux de génie et des pertes pour les constructions. Dans le premier cas, le moteur a été l’énergie. L’industrie du bâtiment est restée le secteur le plus faible de l’économie, reculant de 4 % pour un cinquième pas en arrière de suite (pertes d’une valeur totale de 25 %). La surabondance de locaux dans les immeubles de bureaux au tournant de la décennie a été amplifiée par une baisse de l’utilisation des capacités dans les établissements de fabrication ces dernières années à la suite de l’effondrement du secteur des TIC7.
Pour aggraver ces problèmes, il y a eu un autre bond de 5 % des prix en bâtiment non résidentielle. Les prix ont été poussés en hausse par la vigueur de la construction résidentielle. La concentration des investissements dans les sables pétrolifères a également créé des pénuries locales en Alberta. Comme le prix des machines et du matériel a encore crû de 4 % à cause de baisses à l’importation, les entreprises ont été d’autant plus enclines à délaisser le bâtiment dans leurs investissements.
Au tableau de la croissance des investissements en 2004, le secteur des ressources naturelles a dominé, notamment l’extraction de métaux (+38 %) et l’énergie (+8 %). Ce mouvement suivait une décennie où les investissements dans les mines métalliques n’étaient pas restés à la hauteur de la dépréciation du stock de capital, d’où une perte de valeur de ce stock (c’est la seule perte subie dans une industrie). L’essor des cours énergétiques a évidemment pris l’industrie minière par surprise, car elle n’avait pas prévu accroître ses investissements en 2004. Pour leur part, les entreprises du secteur de l’énergie s’attendent à des gains encore plus imposants en 2005, les gens croyant de plus en plus que les prix resteront à des niveaux élevés des années durant. Signalons enfin que, dans les secteurs des télécommunications et des finances, il devrait aussi y avoir progression à deux chiffres des dépenses en immobilisations.
Une des raisons pour lesquelles les investissements n’ont pas crû plus rapidement l’an dernier est que le secteur de la fabrication a accusé le choc d’une autre forte valorisation du dollar. Les fabricants ont réagi en transformant la hausse prévue de 4 % de leurs investissements en début d’année en une baisse de 1 %, plus particulièrement en bâtiments (diminution de 20 %, une quatrième de suite). Les entrepreneurs ont cependant appris que, pour s’adapter à la montée du dollar, il leur fallait hausser la productivité. Ils projettent en conséquence de relever de 17 % en 2005 leurs dépenses en machines et en matériel, le plus, et de loin, de tous les secteurs. Même si on se trouve à rogner davantage sur les dépenses en construction de nouvelles usines.
Figure 10

La remontée plus rapide des investissements est l’indice que les entreprises ont jugé à la fois plus rentable et plus abordable d’investir. Les bénéfices des sociétés se sont élevés de 18 %, marquant leur meilleure avance depuis l’an 2000 grâce surtout aux industries extractives et notamment aux mines et à l’énergie. Le commerce de détail et le secteur bancaire ont également déclaré de solides gains.
Figure 11

Notons des gains divers d’abordabilité. Il n’y a pas que la baisse des prix des produits de placement, puisque les taux obligataires ont diminué plus rapidement depuis deux ans pour les émissions des sociétés que pour celles des administrations publiques. En fait, ils ont à peine décru dans le secteur des sociétés entre 2000 et 2003, alors qu’ils perdaient presque tout un point dans le secteur public canadien (GDC). Depuis août 2003 cependant, la perte est de près d’un point pour les émissions des sociétés, ce qui les rapproche des émissions des administrations publiques8.
Ce vote de confiance dans la santé financière des sociétés s’explique par un certain nombre de progrès et avant tout par un excédent record de 88 milliards qui a servi à renforcer les bilans (et en particulier à améliorer les ratios de couverture des intérêts et les rapports capitaux d’emprunt-capitaux propres). Par ailleurs, les scandales de régie d’entreprise ont perdu de leur ampleur.
Tous ces facteurs ont eu pour effet de renforcer généralement la situation d’endettement des entreprises et d’accroître la confiance dans les marchés des obligations et des actions. Les nouvelles émissions d’actions ont atteint les 27 milliards l’an dernier. Un fait particulièrement digne de mention est le sommet en quatre ans auquel sont parvenus les premiers appels publics à l’épargne, dont on doit près du tiers aux mines.
L’indice de la bourse de Toronto a monté de 12,5 % l’an dernier. C’est son deuxième gain consécutif après un mouvement baissier qui aura duré deux ans, mais précisons qu’il demeure de 19 % à court de son maximum de septembre 2000. Le marché boursier canadien a eu une performance supérieure à celle du marché américain (en hausse de 9 % surtout après les élections présidentielles), supériorité attribuable en grande partie à la proportion supérieure d’actions de haut vol liées aux ressources naturelles. Les actions des sociétés du secteur de l’énergie ont progressé de 29 % après avoir augmenté de 24 % en 2003. L’étranger s’est empressé d’acheter des actions canadiennes. Il s’en est procuré par une valeur record de 35,8 milliards l’an dernier. En revanche, la valorisation du dollar a dissuadé les Canadiens d’investir en actions dans d’autres pays; cet investissement est tombé à son plus bas niveau depuis le milieu de la décennie 1980.
Les consommateurs jettent leur dévolu sur l’habitation et les biens durables
Le marché de l’habitation a continué à battre son plein l’an dernier. L’accroissement de 47 % en volume de la construction résidentielle depuis 2001 (année où le krach boursier et les attentats terroristes nous ont fait entrer dans une période de taux d’intérêt historiquement bas) est le plus ample en quatre ans sur une période de plus de quatre décennies (figure 12). Chacune de ces années, l’habitation a été le secteur le plus en croissance de la demande. La chute des taux d’intérêt qui s’est amorcée en 2001 s’est accompagnée d’un net déplacement en faveur de la construction neuve sur le marché de l’habitation, alors qu’on assistait à un ralentissement des dépenses sur le marché de la rénovation.
Figure 12

Le patrimoine des ménages a fait un bond de 5 %, soutenu par la fermeté tant du marché de l’habitation que du marché boursier. Les ménages se sont endettés davantage pour financer cet engouement pour l’habitation. Les ménages devaient 900 milliards l’an dernier, bien que leur actif net a atteint 4,4 billions.
La récente montée des prix de l’habitation et de l’endettement fait craindre qu’une bulle ne soit en train de se former sur le marché de l’habitation comme ce qui s’est passé sur le marché boursier en l’an 2000. Selon la plupart des indicateurs cependant, il faut penser que le gros du mouvement récent de renchérissement de l’habitation est largement là pour compenser les pertes des années 1990. Le rapport entre le prix actuel de l’habitation et le revenu disponible demeure inférieur à sa moyenne de 1990 à 1994. Il ne semble pas non plus y avoir un déséquilibre dans le rapport entre prix d’acquisition et prix de location. L’augmentation des prix sur le marché de la revente comme sur le marché de l’habitation neuve s’est faite plus lente l’an dernier. Elle n’a jamais dépassé les 10 % cette décennie après s’être établie en moyenne à moins de 1 % par an dans la décennie 19909. L’avoir net des ménages est toujours en hausse de près de moitié depuis l’an 2000, car la valeur de l’habitation a progressé plus rapidement que l’endettement hypothécaire.
Figure 13

Les tendances des dépenses de consommation ont été dictées par la multiplication des appareils électroniques neufs, souvent en combinaison avec des prix nettement réduits (une grande partie de ces marchandises sont importées de l’Asie du Sud-Est). Les biens durables autres que les automobiles ont mené le mouvement, soutenus par les ordinateurs et les produits électroniques destinés au foyer dont les prix ont connu une croissance à deux chiffres. Les grands détaillants ont signalé des ventes en plein essor de grands écrans de télévision et de lecteurs de CD et de DVD. La baisse des prix à l’importation a aussi diminué les prix des vêtements. Cela a contribué à une progression de 5 % des ventes en volume. Mentionnons enfin que les certificats-cadeaux se sont encore multipliés avec pour résultat une transformation des tendances des ventes à l’occasion des fêtes de fin d’année et une majoration des marges bénéficiaires au détail.
Les ventes de véhicules ont régressé une deuxième année de suite, plus en fait les ventes de voitures que les ventes de camions. La hausse des tarifs d’assurance et du prix de l’essence a eu plus de poids que la constante prolifération des programmes spéciaux d’encouragement à l’achat. Les sociétés automobiles à établissements transplantés ont pris 20,7 % du marché contre seulement 15,9 % en 2000 et 5,3 % en 1992. C’est ainsi que Honda a dépassé Ford comme troisième constructeur automobile en importance au Canada.
Le fort renchérissement de l’essence à la pompe n’a pas empêché les automobilistes d’acheter 2,1 % d’essence de plus10. Une explication partielle est que les utilitaires sportifs ont progressé jusqu’à mobiliser 17 % des ventes de l’industrie de l’automobile au pays (c’est un peu moins que leur part de marché aux États-Unis).
Pour aiguillonner les dépenses, il y a eu l’élévation du revenu personnel, même en période de modération de l’inflation. La progression du revenu du travail a atteint un sommet en quatre ans de 4,1 %. La décroissance de l’emploi à temps partiel a ralenti la croissance de l’emploi global, mais il faut dire que l’emploi à plein temps s’est accru de 2,4 %.
Figure 14

L’an dernier, l’impôt sur le revenu des particuliers a légèrement monté de 15,3 % à 15,5 % du revenu. La hausse est certes modeste, mais c’est la première depuis 1998. L’impôt fédéral sur le revenu a augmenté plus rapidement que l’impôt provincial, les provinces comptant plus sur les cotisations sociales pour augmenter leurs recettes.
Si l’excédent des administrations publiques s’est élevé l’an dernier, c’est à cause de la fermeté des revenus et du ralentissement des dépenses. Les rentrées publiques se sont accrues de 5 % surtout grâce à des recouvrements supérieurs d’impôt tant des particuliers que des sociétés dans un contexte de croissance accélérée des revenus. Le ralentissement des dépenses a été plus prononcé dans le cas des projets d’investissement. Ceux-ci étaient en hausse de 2 % seulement en volume, mais les dépenses en infrastructure avaient presque doublé les cinq années précédentes. L’excédent des administrations publiques a presque entièrement pris de l’ampleur au palier fédéral, car les provinces ont changé la structure des redevances perçues sur les ressources naturelles11.
Une croissance plus égale
La dernière année est digne de mention pour une répartition plus égale de la croissance de l’industrie. Ces dernières années, il y avait surtout eu des gains rapides dans une poignée de secteurs (secteur de la fabrication en 2000, secteur de l’habitation en 2001, etc.) et des pertes cuisantes dans d’autres (industrie touristique en 2003, industrie agricole par la sécheresse en 2002, etc.). Il en est résulté des écarts de croissance à deux chiffres entre les branches d’activité aux meilleurs et aux pires résultats, mais en 2004 les différences ont été ramenées à six points seulement (on passe d’une valeur de 6 % dans le commerce de gros à une valeur nulle dans les services publics). D’un point de vue statistique, l’écart-type de la croissance du PIB dans les 17 grandes industries par rapport à la moyenne a constamment diminué, passant de 3,6 en 2001 à 1,5 seulement l’an dernier.
Figure 15

Si les valeurs de croissance ont été moins dispersées l’an dernier, c’est en partie qu’il n’y a pas eu de grandes industries qui aient accusé des pertes. L’industrie de l’hôtellerie et de la restauration s’est remise de ses pertes provoquées par l’épidémie de SRAS en 2003. Dans le secteur de la fabrication, les valeurs se sont améliorées partout sauf pour le papier et le vêtement après une stagnation de sa performance l’année précédente. Un exemple particulièrement éloquent est le redressement des fabricants de TIC après trois ans de recul. La remontée des échanges internationaux a également aidé les transports à oublier une année de vaches maigres en 2003. C’est dans les arts et les loisirs que le ralentissement a été le plus marqué avec des pertes pour les spectacles sportifs.
Toutes les provinces ont profité de gains sur le marché de l’habitation et, dans une moindre mesure, dans l’extraction des ressources. En fait, il n’y en a pas qui aient vu l’emploi fléchir une seule année depuis 2001, ce qui représente un exploit pour un pays aussi diversifié que le Canada en proie à une succession de chocs, depuis la sécheresse et les épidémies jusqu’à la montée en flèche du dollar.
Le résultat net en a été une répartition plus égale de la croissance de l’emploi parmi les provinces. L’écart-type par rapport à la moyenne nationale a été de 0,06 seulement. C’est le tiers des valeurs de 2000 et 2001 où l’Ontario a dominé pour la croissance. Depuis, cette province est revenue à la moyenne nationale. Seuls le Manitoba et la Saskatchewan ont pris un net retard l’an dernier (en raison de la faiblesse de leur agriculture). L’Alberta a prédominé au tableau de la croissance grâce à son secteur de l’énergie.
Figure 16

Que toute l’accélération de la production soit venue des exportations nous éclaire davantage sur les causes du ralentissement de 2003. À l’époque, on a beaucoup parlé d’une suite de chocs négatifs : SRAS, maladie de la vache folle, grèves, pannes d’électricité, ouragans, incendies, etc. Mais comme la demande intérieure a été en croissance soutenue les deux années, c’est le ralentissement des exportations qui, en réaction à la montée initiale du dollar, a le plus amorti la croissance en 2003.
Les intempéries ont causé autant de dégâts en 2004 qu’en 2003, mais comme l’économie était en relance, on y a moins vu un problème. Un printemps et un été froids et pluvieux dans les Prairies et les provinces centrales ont réduit les récoltes et les incendies, mais des conditions très sèches sur la côte ouest ont livré plus d’hectares aux incendies de forêt dans le seul Yukon que dans tout le Canada l’an dernier.
Des prix à l’importation en baisse contiennent l’inflation
Au Canada, le taux d’inflation a baissé à 1,9 %, tombant sous le taux américain (2,7 %) pour la première fois en trois ans. On revient ainsi au mouvement caractéristique des années 1990 où, huit ans de suite, l’IPC s’est élevé plus lentement au nord de la frontière. La forte baisse des prix à l’importation au Canada a favorisé ce ralentissement, alors que la dévalorisation du dollar américain et le renchérissement des hydrocarbures alourdissaient la facture des importations chez notre voisin du sud. Comme contrepoids partiel à la décroissance initiale des prix à l’importation en 2003 au pays, il y a eu des primes d’assurance et des taxes sur le tabac nettement majorées, ce qui ne devait pas se reproduire dans les deux cas en 2004.
Les prix ont le plus diminué pour les biens durables et semi-durables ayant le plus de contenu importé. Une baisse record de 1,6 % des prix des biens durables a été la plus imposante de cinq pertes annuelles consécutives. Le long dérapage des prix est entraîné par les ordinateurs et les biens électroniques, ce qui traduit l’évolution rapide de la technologie. La diminution relevée dans le cas des biens semi-durables était la troisième de suite; on la doit surtout aux vêtements dont les prix ont baissé à l’importation. Enfin, les prix des importations en provenance de la Chine ont décru à cause de la politique chinoise de cours fixes du change par rapport à un dollar américain en dévalorisation.
Les consommateurs n’ont pas toujours tiré parti de la baisse des prix à l’importation. Les détaillants ont profité de l’occasion pour étoffer leurs marges bénéficiaires, tendance qui a pris naissance en 2003. Il s’agissait de compenser l’effritement des marges qu’ils ont dû accepter lorsque le dollar a perdu de sa valeur et que les prix se sont élevés à l’importation plus tôt dans la décennie.
Même le renchérissement des services au Canada s’est fait plus lent pour se situer au bas niveau de 2,3 % en cinq ans. Les prix des services personnels se sont accrus encore moins (1,8 %) en partie à cause des prix largement réduits des voyages à l’étranger (aspect que n’appréhende pas l’IPC qui vise uniquement les biens et les services au Canada).
Conclusion
Après une décennie de croissance par les exportations dans les années 1990, le Canada s’est appuyé sur les dépenses intérieures pour soutenir la croissance de son économie ces dernières années. L’an dernier, la demande a progressé tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation. La demande intérieure était toujours en croissance rapide et les dépenses des ménages ont été de mieux en mieux soutenues par une accélération des investissements des entreprises. Les immobilisations se sont affermies dans tout le secteur, les marchés financiers ayant de plus en plus la conviction que le surinvestissement et la piètre régie d’entreprise qui avaient marqué le début du millénaire appartenaient à un passé révolu.
Mais les ressources en général et l’énergie en particulier ont été le moteur à l’origine de la moitié environ de toute la progression des investissements. Des cours énergétiques en plein essor ont fait naître des excédents commerciaux records au pays. Avec des exportations en hausse et un dollar en valorisation qui allège notre facture à l’importation, les termes de l’échange ont nettement tourné une fois de plus à l’avantage du Canada, d’où la possibilité pour les Canadiens de consommer plus que ne l’indiquerait le volume de la production.
L’année 2004 s’est aussi distinguée par l’absence de toute grande perte sectorielle ou régionale de production ou d’investissement et l’emploi a monté dans toutes les provinces. Une répartition plus égale de la croissance s’explique par des gains pour les ressources et l’habitation dans toutes les régions, ainsi que par le pouvoir d’achat croissant qu’apporte la valorisation du dollar.
Études spéciales récemment parues
* (613) 951-9162 ou oec@statcan.ca.
1 Pour en savoir plus sur le Command-GDP, voir l’article de F. Roy « Termes de l’échange, PIB et taux de change » publié dans le numéro de mars 2004 de L’Observateur économique canadien, no 11-010 au catalogue de Statistique Canada ou vu dans notre site web.
2 Il a été question du clivage régions rurales-régions urbaines dans l’article de fond du mois dernier. Une prochaine étude analytique indiquera que les différences entre les provinces sont largement fonction de la taille relative de leurs collectivités urbaines et rurales : voir D. Beckstead et M. Brown dans « Inégalités provinciales du revenu à travers le prisme rural-urbain : tirées du recensement de 2001 ».
3 Au Canada, la production cinématographique a baissé pour la première fois depuis 2001.
4 Avant la découverte du gisement pétrolier de Leduc en 1947, le Canada importait 88 % de son pétrole, surtout en provenance des États-Unis.
5 Perspectives économiques de l’OCDE, décembre 2004, p. 17.
6 Bien que les technologies récemment brevetées soient de nature à réduire ou à éliminer le besoin de gaz naturel pour la transformation du bitume brut.
7 L’utilisation des capacités s’est en effet redressée l’an dernier, mais on doit surtout cette remontée aux industries de biens d’équipement, dont les taux comptaient parmi les plus bas.
8 L’écart de rendement obligataire entre les émissions des sociétés et celles des administrations publiques a été encore plus grand aux États-Unis, culminant à 3 points en 2002 avant de tomber à un minimum en six ans de 1,1 point l’an dernier (Business Week, 10 janvier 2005). Et toutes les compagnies n’ont pas vu leurs taux tomber : le rendement des obligations des grandes compagnies nord-américaines de voitures ont augmenté à presque 10 %.
9 Dans chaque cas, la croissance a été à deux chiffres vers la fin des années 1980, mouvement suivi d’une décroissance au début des années 1990.
10 La consommation globale de produits pétroliers s’est accrue de 4 % l’an dernier.
11 Les provinces ont abaissé leurs redevances sur la nouvelle production jusqu’à ce que les entreprises recouvrent leurs coûts en capital; la contrepartie était une part perçue sur les bénéfices par la suite. |


































 Consulter la version la plus récente.
Consulter la version la plus récente.