Étude spéciale
Revue de fin d’année
par P. Cross*
Introduction
En 2003, les grands thèmes ont été
dictés par les événements internationaux. L’accélération
de l’intégration de la Chine (symbolisée par
l’accession de ce pays à l’Organisation mondiale
du commerce vers la fin de 20011)
et d’autres pays en émergence économique à
l’économie mondiale a continué de transformer
rapidement le panorama économique, plus particulièrement
dans le cas des échanges et des investissements directs.
La part des importations des États-Unis en provenance de
la Chine s’est accrue pour atteindre 12,1 %, au deuxième
rang devant le Mexique et derrière le Canada dont la part
atteint 17,8 %. Dès l’an dernier, la Chine était
devenue une grande consommatrice de produits de base (ses importations
pétrolières ne sont aujourd’hui dépassées,
par exemple, que par les importations américaines), d’où
un effet de stimulation sur les prix de nos exportations de métaux
et d’énergie2.
Figure 1

Les événements récents ont aussi fait voir
que l’intégration économique qui prend de l’ampleur
dans le monde nous expose à des situations qui ne dépendent
guère de notre volonté. Les attentats du 11 septembre
ont instauré une ère de terreur internationale. La
propagation du virus du SRAS de la Chine au Canada, conjuguée
à l’apparition du virus du Nil occidental l’année
précédente, indique avec quelle rapidité les
maladies peuvent suivre les flux transfrontaliers du commerce. Par
ailleurs, la découverte du premier cas de maladie de la vache
folle en Alberta a fermé la plupart des marchés étrangers
à notre viande de bœuf. Enfin, les hostilités
qui ont éclaté en Iraq ont largement réduit
au deuxième trimestre les voyages internationaux à
destination et en provenance du Canada. Enfin, la panne d’électricité
en Ontario provient d’installations du mid-ouest américain.
Pour notre pays, le grand événement
économique de la dernière année a été
la montée du dollar canadien vis-à-vis du dollar américain.
La hausse de 21,7 % de notre dollar qui, dans l’année,
est passé de 63,39 à 77,13 cents américains,
est la plus ample variation positive ou négative qui ait
été observée en 12 mois dans notre histoire.
Entraîné par un déficit record au compte courant
des États-Unis, le dollar américain a chuté
par rapport à diverses grandes monnaies. Toutefois, plusieurs
pays asiatiques (et notamment la Chine et le Japon) ont résisté
à l’appréciation de leurs monnaies respectives3,
reportant sur l’euro (qui a atteint un sommet) et les dollars
australien et canadien le gros de l’adaptation à la
dépréciation du dollar américain.
Production
Le PIB réel a décéléré de 3,3 %
à 1,7 %. C’est ainsi que le Canada et l’Allemagne
ont été les deux seuls pays membres du Groupe des
Sept à voir ralentir la croissance de leur économie
l’an dernier. Le Canada avait dominé au tableau de
la croissance en 2002 et se situait toujours en 2003 à un
rang intermédiaire au sein du Groupe des Sept. Il était
devancé par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon,
qui présentaient des taux de progression qui se sont accélérés
à près de 3 %, mais laissait encore loin derrière
les grands pays européens continentaux qui, invariablement,
avaient du mal à dégager un faible taux de progression
dans cette deuxième année de l’adoption d’une
monnaie commune. Depuis le début de la décennie, le
taux annuel de croissance du PIB canadien s’est établi
en moyenne à 2,3 %. C’est la moitié du
rythme vertigineux de 5 % en période de culmination
de l’économie de 1998 à 2000.
Au cours de l’année, on a beaucoup
discuté de cette succession presque épique de chocs
négatifs de l’économie : épidémie
de SRAS qui a débuté en mars à Toronto, découverte
d’un cas de maladie de la vache folle (ESB) en Alberta an
mai, grève à Inco en juin, panne d’électricité
en Ontario en août, ouragan Juan par la suite en Nouvelle-Écosse
et incendies de forêt en Colombie-Britannique. Il reste que
chaque année apporte son cortège de catastrophes.
Par exemple, la sécheresse a coûté des milliards
aux producteurs céréaliers des Prairies en récoltes
perdues au cours des deux années précédant
2003, le temps perdu dans des arrêts de travail a touché
un sommet de cinq ans en 2002 (73 % de temps perdu de plus qu’en
2003), tandis que les incendies de forêt ont été
si intenses au Québec que le ciel s’en est trouvé
brouillé jusqu’à New York au sud. Rien n’indique
statistiquement que les bouleversements de 2003 aient constitué
un facteur considérable de ralentissement économique
dans l’ensemble de l’année, mais on sait qu’ils
ont influé sur la répartition trimestrielle de la
croissance. (La Banque du Canada estime que le SRAS, l’ESB
et la panne d’électricité ont retranché
0,3 point au PIB aux deuxième et troisième trimestres,
mais l’économie devait regagner 0,2 point au quatrième4.)
Que ces événements aient eu de
légers effets sur le PIB s’explique peut-être
en partie par la taille énorme de notre économie aujourd’hui.
Avec un PIB de 1,2 billion de dollars en valeur annuelle, même
un événement marquant comme la perte de 1 milliard
de dollars (aux taux annuels) occasionnée par la grève
à Inco ne touche que 0,1 % de la production alors que
1 milliard de dollars représentait 1 % du PIB en 1972. Il
faut ajouter que certains de ces événements influent
davantage sur la répartition du revenu que sur son ordre
de grandeur. Ainsi, la perte de débouchés à
l’exportation des producteurs bovins à cause de la
crise de la vache folle a été partiellement compensée
par un accroissement du pouvoir d’achat des consommateurs
de viande de bœuf dans un contexte de baisse des prix, ainsi
que par les gains qu’ont pu faire les producteurs d’aliments
de substitution (volaille, poisson et fruits de mer, etc.). Le plus
grand effet persistant d’un de ces événements
semble avoir été un recul pour une industrie touristique
canadienne dont la production annuelle a perdu l’équivalent
de 0,1 % du PIB5. Mais ce n’est
pas dire que le SRAS en est entièrement responsable, car
le dérapage a commencé après les attentats
du 11 septembre et s’est accentué par la guerre
en Iraq et l’appréciation du dollar canadien l’an
dernier.
Il reste que les solides gains réalisés aux premier
et quatrième trimestres se sont accompagnés de valeurs
presque nulles de croissance aux deuxième et troisième
trimestres. L’inertie du PIB réel pendant près
de six mois soulève inévitablement la question de
savoir comment caractériser cette période dans l’optique
des cycles économiques, et nous porte même à
faire la comparaison avec des récessions comme celles de
1981-1982 et 1990-1992.
Plutôt que de retrouver la forme habituelle en V d’une
économie en récession (figure 2), nous devons plus
justement comparer le relâchement au milieu de 2003 à
1986, période où l’économie s’est
enlisée au premier semestre, accusant notamment une baisse
de 0,5 % du PIB mensuel de novembre 1985 à juin 1986.
La source de faiblesse était le secteur de l’énergie
(figure 3), les cours pétroliers s’étant affaissés
à moins de 10 $ le baril avec pour résultat une
contraction de la production pétrolière et gazière
de 6 % et un effondrement des dépenses d’exploration
et de mise en valeur de 63 %. Ce sont des pertes qui ont enfoncé
le PIB même si on ne tient pas compte des effets secondaires
sur les industries d’approvisionnement du secteur pétrolier
ni des pertes de pouvoir d’achat des travailleurs. À
plus long terme, il y a eu croissance de l’économie
à cause de l’effet de stimulation sur les autres secteurs
du recul des taux d’inflation et d’intérêt
ayant suivi la baisse des cours pétroliers.
Figure 2
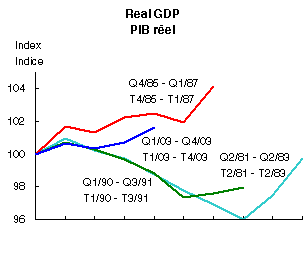
Figure 3
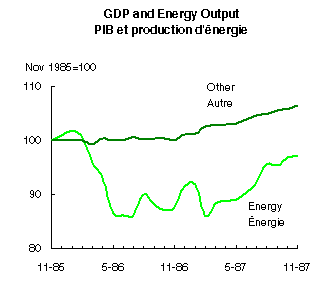
Des circonstances semblables semblent avoir causé l’inertie
de notre économie cette année. Une grande partie des
industries exportatrices ont été heurtées de
plein fouet par une brusque évolution des prix relatifs attribuable
à la montée du dollar et dont les conséquences
favorables sur la demande intérieure se manifestent plus
lentement alors que les prix et les taux d’intérêt
ont baissé comme en 1986. Pour accentuer la faiblesse de
l’économie à court terme, il y a eu les événements
que nous avons énumérés et, plus particulièrement,
la panne d’électricité en août. Ce dernier
événement a véritablement été
un important facteur de marasme au milieu de l’année,
provoquant la perte la plus cuisante d’heures travaillées
et la contraction la plus générale de la production
jamais observée au moment même où l’économie
commençait à secouer sa léthargie du deuxième
trimestre (le PIB avait fait un bond de 0,5 % en juillet).
Sans ces événements, la croissance au troisième
trimestre aurait été plus forte et celle du quatrième,
plus faible, une évolution moins susceptible de ramener la
question à savoir s’il y a eu ou non une récession.
La faiblesse des industries de fabrication exportatrices n’en
a pas moins ralenti le mouvement foncier de l’économie
en réduisant la croissance près de zéro, laissant
ainsi le PIB vulnérable devant de tels chocs négatifs.
Ménages
Les dépenses des ménages ont connu une troisième
année consécutive de solide progression. L’habitation
a encore montré la voie, tout en étant incapable de
maintenir sa croissance à deux chiffres des deux années
précédentes. Les dépenses de consommation se
sont encore élevées d’un peu plus de 3 %.
Toutefois, la croissance des dépenses en biens durables a
chuté de 9 % à 2 % en grande partie à
cause du marasme des ventes d’automobiles. La demande de services
a crû plus rapidement, bien que ce gain tienne en majeure
partie à une flambée des voyages à l’étranger,
ce qui n’est guère de nature à aider les détaillants
au pays.
La demande d’automobiles a montré des signes de fatigue
ou de saturation, fléchissant de 6 % après avoir
progressé pendant sept ans. Il reste que le nombre de véhicules
vendus a été le deuxième en importance dans
l’histoire. Le marché de l’automobile a présenté
d’importants éléments d’évolution.
La part de marché des trois premiers producteurs nord-américains
a décru de 59 % à 56 %; on est loin des
74 % du début de l’essor des ventes d’automobiles
en 1995. Qui plus est, ces producteurs ont perdu beaucoup de terrain
sur le marché lucratif des camions, des minifourgonnettes
et des utilitaires sportifs, qui était pourtant leur principale
source de vigueur, puisque la proportion des ventes de voitures
de tourisme a diminué de 65 % en 1995 à 41 %
l’an dernier.
L’élévation du revenu personnel disponible s’est
faite plus lente, le taux de progression passant de 4,7 % à
2,8 % et devançant à peine les hausses de prix.
Dans une situation de croissance incessante des dépenses
de consommation et avec un marché de l’habitation qui
battait toujours son plein, les ménages ont dû trouver
d’autres moyens de financer leurs achats en érodant
leurs épargnes et en multipliant les emprunts. Le taux d’épargne
est tombé à un bas niveau record, passant de 4,2 %
à 2,0 % et dégageant ainsi 15 milliards.
Par ailleurs, les consommateurs ont emprunté une somme record
de 50 milliards, dont 30 par le seul crédit hypothécaire.
À 2,0 %, le taux d’épargne personnelle
a été aussi bas au Canada qu’aux États-Unis
pour la première fois depuis 1971 (au second semestre, le
taux canadien le cédait même au taux américain
avec 1,4 % contre 2,0 %). Comme les dépenses de
consommation ont augmenté exactement au même rythme
dans les deux pays, la différence tient aux revenus. Pour
des taux comparables de progression du revenu personnel, la grande
différence a été l’élévation
bien plus rapide du revenu disponible chez notre voisin du sud (4,4 %
contre 2,8 %). Depuis deux ans, l’impôt américain
sur le revenu s’est allégé de 20,5 % (ou
255 milliards), presque entièrement au niveau fédéral,
transformant une croissance lente du revenu personnel en une solide
avance du revenu disponible (tout en créant un imposant déficit
budgétaire). En revanche, l’impôt sur le revenu
des particuliers n’a guère changé au Canada
avec un taux de 15,2 % du revenu personnel, et ce, après
trois années de décroissance où ce même
taux devait passer de 17 % en 1999 à 15,4 % en
2002 (figure 4). La faiblesse des taux d’intérêt
et l’enrichissement du patrimoine des ménages ont amené
de bas niveaux d’épargne personnelle dans l’un
et l’autre de ces pays.
Figure 4

Le bilan du secteur des particuliers a continué à
délaisser les avoirs financiers au profit des avoirs non
financiers, mouvement qui est né de l’effondrement
boursier. Le volet non financier des portefeuilles des ménages
s’est étoffé trois années de suite, passant
de 42,4 % à 45,5 %, sa valeur la plus élevée
depuis 1992 (figure 5). Le gros de cette progression s’explique
par l’accroissement du patrimoine dans le secteur de l’habitation.
La dernière fois que les ménages ont eu une si longue
période de délaissement à l’égard
des avoirs financiers est au moment de la flambée inflationniste
de 1973-1974, époque où les avoirs non financiers
en sont venus à représenter 54 % des portefeuilles.
Depuis cette période, il y a eu un constant mouvement qui
s’est opéré en faveur des avoirs financiers
jusqu’en l’an 2000, tout particulièrement
en période de crête boursière dans les années 1990.
Figure 5

Secteur canadien des entreprises
Malgré une modeste reprise des investissements des entreprises,
le secteur de l’entreprise a encore été marqué
par l’abondance de son épargne nette, qui est passée
de 35 (déjà un record) à 57 milliards
de dollars de 2002 à 2003. L’accroissement de l’excédent
à ce compte a eu pour origine un bond de 18 % des bénéfices
non répartis : les bénéfices avant impôt
ont secoué une inertie de deux ans par une progression à
deux chiffres, alors que les paiements de dividendes évoluaient
en baisse.
Les entreprises non financières ont consacré le plus
clair de leurs moyens financiers améliorés à
la poursuite de la restructuration de leurs bilans. Elles ont réduit
leur endettement à court terme à un rythme accéléré
(15 milliards de dollars), tout en se garantissant pour l’avenir
de bas taux d’intérêt par des émissions
obligataires d’une valeur de 18 milliards. Le redressement
boursier a soutenu de nouvelles émissions d’actions
de 31 milliards (ce qui est toujours bien moins que la valeur
de culmination de 54 milliards relevée en 2000).
La volonté d’étoffer les
bénéfices et d’améliorer les bilans a
peut-être pour origine partielle la perception de la faiblesse
des finances des entreprises ces dernières années.
Dans les sociétés, le désendettement a été
important tout au long de 2001 et 2002 (mais moins important qu’aux
États-Unis ou dans l’Union européenne). Par
ailleurs, la prime de risque des titres ayant droit à la
cote BBB a monté en flèche, passant de 150 centièmes
à plus de 300 vers la fin de 2002, tandis que le taux général
de défaut de paiement dans les entreprises faisait un bond,
passant d’une valeur trimestrielle de 20 en 2000 à
100 en 20036.
Toutes ces mesures de la santé financière
des entreprises ont fait voir une amélioration fondamentale
l’an dernier. Le nombre de décotes de solvabilité
a fortement diminué au Canada. La diminution des pertes sur
prêts a largement concouru à la croissance des bénéfices
bancaires. Les marges de risque sur les créances des entreprises
n’avaient jamais autant rétréci depuis 1997.
Avec la baisse rapide des taux d’intérêt sur
leurs obligations, les trésoriers des entreprises ont délaissé
le crédit à court terme pour le crédit obligataire
et éloigné les échéances de leur passif7.
Si les entreprises ont opté pour la prudence, c’est
aussi que l’économie est entrée en pays inconnu
depuis la montée inégalée du dollar canadien
par rapport au dollar américain.
Les résultats de ce réaménagement des bilans
ressortaient de toutes les grandes mesures de la santé financière
des entreprises. Dans les entreprises non financières, le
ratio capital d’emprunt-capitaux propres a continué
à diminuer comme il le fait depuis dix ans. Il a chuté
à 0,62 en 2003, se situant à son plus bas niveau depuis
1970. Le ratio avoir à court terme-passif à court
terme ou ratio de liquidité relative s’est élevé
à 0,89, autre sommet depuis 1970. Enfin, le ratio dette à
court terme-dette à long terme est tombé à
un minimum de 9,46 pour la période postérieure à
1964. Deux décennies durant, il avait oscillé autour
de 20 avant de se mettre à descendre dans les années
1990.
Figure 6

Les bourses du monde ont mis fin aux cours baissiers des trois années
précédentes par un gain de 29 %, le meilleur
en sept ans, grâce à l’essor du marché
asiatique. Les nouveaux marchés ont dominé dans ce
mouvement de relance avec une hausse de 64 %. La bourse de
Toronto a marqué une avance de 24 %, à peu près
autant qu’aux États-Unis.
Si le marché boursier va mieux, c’est
que divers autres facteurs sont entrés en jeu. Les marchés
ont entamé leur redressement presque immédiatement
après la fin rapide des grands combats en Iraq. Les bénéfices
ont réévolué en hausse après un ralentissement
de deux ans. Il y a encore eu des scandales dans les sociétés,
mais ceux-ci n’avaient pas l’ampleur des scandales des
dernières années8.
Le redressement serait en partie à mettre au compte d’efforts
de rétablissement de la confiance des investisseurs dans
les rapports financiers, les normes de vérification et la
régie d’entreprise. Le Canada s’est doté
d’un Conseil canadien sur la reddition de comptes pour l’amélioration
et le contrôle des vérifications9.
La montée boursière a aussi adouci les inquiétudes
au sujet de la capitalisation insuffisante des régimes de
retraite.
Les investissements des entreprises ont progressé de 3,4 %
en volume, s’extirpant d’un marasme ayant duré
deux ans. Les entrepreneurs ont surtout investi en ordinateurs et
en logiciels que de fortes baisses de prix leur rendaient plus accessibles.
De plus, le regain d’intérêt pour l’investissement
en fabrication s’est traduit par une progression à
deux chiffres dans le cas de la machinerie industrielle. En volume,
les dépenses demeurent faibles dans la plupart des autres
secteurs, particulièrement en meubles, en matériel
de transport et en appareils de télécommunication.
La répartition industrielle de la croissance des investissements
semble indiquer que des facteurs autres que les baisses de prix
ont joué un plus grand rôle. Les 14 principaux
groupes d’industries pourraient avoir profité de la
décroissance des prix des machines et du matériel
importés pour investir davantage, mais 5 seulement l’ont
fait et, sur ce nombre, la fabrication est le groupe qui a de loin
le plus accru ses immobilisations, relevant ses dépenses
de 1,5 milliard (11 %) malgré des pertes de rentabilité.
C’est le signe évident que l’impératif
d’amélioration de la productivité, dans un contexte
d’intensification des pressions concurrentielles par l’appréciation
du dollar, a représenté un souci de tous les instants.
Les fabricants ont élagué leurs dépenses en
construction, indice d’une sous-utilisation croissante des
capacités. Dans l’ensemble, ces dépenses ont
toutefois augmenté, surtout grâce aux projets dans
le domaine du pétrole et du gaz « classiques ».
Les investissements ont été peu fermes dans la plupart
des autres secteurs. L’essor des cours des produits de base,
et notamment des cours des métaux, ne les a pas stimulés,
du moins jusqu’en 2004, année où une hausse
de 35 % est prévue. Le secteur des TIC a sabré
ses investissements, en particulier les sociétés de
télécommunication, les fournisseurs de services Internet
et les fabricants de produits informatiques et électroniques.
Le secteur des finances qui investissait abondamment vers l’an 2000
a continué à réduire ses immobilisations (taux
de régression à deux chiffres).
Une fois de plus, le secteur public a multiplié les investissements,
surtout en infrastructures locales. Les services publics ont également
relevé leurs dépenses, surtout les services des eaux
et des eaux usées. Après des années de négligence,
ils ont doublé les sommes investies depuis la catastrophe
de Walkerton. Les services de santé et les universités
ont aussi présenté des gains à deux chiffres,
ces dernières à la faveur de l’arrivée
de la double cohorte de diplômés des écoles
secondaires ontariennes avec la disparition de la 13e année.
L’accumulation de stocks s’est un peu accrue l’an
dernier. Le gros du phénomène tient au regarnissement
des stocks du réseau de distribution céréalière,
lesquels s’étaient appauvris depuis deux ans à
cause de mauvaises récoltes. Par ailleurs, la fermeture des
frontières aux exportations canadiennes de viande de bœuf
a obligé les producteurs canadiens à garder des cheptels
plus nombreux. Les stocks non agricoles ont largement augmenté
au premier semestre, plus particulièrement lorsque les livraisons
manufacturières se sont affaissées, mais le mouvement
était déjà contenu à la fin de l’année.
Balance des paiements
Les flux transfrontaliers de marchandises ont baissé dans
les deux directions pour une troisième année d’affilée,
en dépit d’une croissance explosive avec la Chine.
L’excédent au compte courant a gagné 2,4 milliards
l’an dernier au Canada pour approcher de 26 milliards,
annulant en majeure partie sa baisse de l’année précédente.
Cette progression s’explique par un excédent en croissance
au compte des biens et un déficit en décroissance
au compte des revenus de placements. La montée du taux de
change a joué un rôle dans les deux cas. Au compte
des biens, les prix ont baisé plus rapidement à l’importation
qu’à l’exportation, ce que l’on doit en
partie à la hausse tant du taux de change que des prix de
nos produits énergétiques. Il en a coûté
moins cher pour le service de notre dette extérieure grâce
à l’appréciation du dollar, plus particulièrement
pour les créances en dollars américains.
Le tourisme est le seul secteur où le bilan commercial s’est
nettement détérioré l’an dernier. Le
déficit à ce compte a plus que doublé pour
atteindre un sommet de 4,3 milliards en 10 ans, ce qu’on
doit surtout imputer à une ample diminution (12,8 %)
des dépenses des visiteurs au Canada. C’est la première
fois en 15 ans que décroît le nombre de visites
en sol canadien (et la baisse en 1987 n’était pas étonnante
étant donné la fin de l’expo en C.-B.). Il y
a eu à peu près autant de visiteurs de moins en provenance
des États-Unis que des pays d’outre-mer, d’où
l’impression que le SRAS et la guerre en Iraq ont joué
au moins un aussi grand rôle que le taux de change américain.
Par ailleurs, les dépenses des voyageurs canadiens à
l’étranger ont légèrement monté
de 2 %. Cette hausse a entièrement été
observée outre-mer.
Nos échanges avec la Chine étaient toujours en croissance
rapide (figure 7). Les importations ont doublé depuis 1999.
Elles se sont notamment accrues de 16 % l’an dernier.
Ce pays a été à l’origine de 5,5 %
de toutes les importations l’an dernier, presque deux fois
plus que le Japon ou la Grande-Bretagne et à peu près
autant que les autres pays de l’Union européenne (7,6 %).
Le redressement des cours des produits de base a fait remonter les
exportations de 13 % après un fléchissement l’année
précédente. Celles-ci ont progressé des trois
quarts depuis 1999; partant d’un niveau plus bas, cependant,
les exportations traînaient derrière les importations
par presque 14 milliards de dollars l’an dernier (versus 124
milliards de dollars aux États-Unis). Le déficit commercial
avec la Chine représente 1,1 % du PIB dans les deux pays.
Figure 7

Dans l’année, certaines tendances récentes au
bilan commercial sectoriel se sont consolidées. Les produits
énergétiques ont présenté un excédent
supérieur à celui de l’exploitation forestière
d’abord en 2001, et ce, par moins de 1 milliard de dollars.
Depuis toujours, la foresterie dégageait l’excédent
le plus imposant. En 2003, l’écart a fait un bond à
10 milliards (41,4 contre 31,5 milliards). Dans le commerce
des machines et du matériel, le déficit le plus considérable
qu’ait accusé un secteur avant 1998 s’est constamment
contracté, passant de 22,4 milliards à 9 seulement
l’an dernier (en partie à cause de la forte baisse
des prix à l’importation). Ce sont les biens de consommation
qui laissent aujourd’hui le déficit le plus lourd,
soit 29,1 milliards l’an dernier, plus du triple de celui
des machines et du matériel. Cette combinaison d’un
déficit relativement modeste au compte des biens d’équipement
et d’un déficit bien plus important au compte des biens
de consommation rappelle les tendances déficitaires du commerce
américain (dans l’ensemble, celui-ci est déficitaire
et le commerce canadien est excédentaire grâce au secteur
des ressources). L’excédent canadien au compte des
produits agricoles et automobiles a légèrement diminué
l’an dernier par suite de la fermeture de grands marchés
à nos exportations de viande de bœuf et à une
plus grande pénétration des importations sur le marché
canadien de l’automobile.
Les investissements directs étrangers au Canada ont été
les plus lents en dix ans. En fait, les Canadiens ont racheté
durant la deuxième moitié de l’an dernier des
entreprises à des investisseurs directs de l’étranger
pour la première fois depuis 1990, l’appréciation
du dollar ayant rendu les entreprises canadiennes moins abordables
aux étrangers. L’appréciation du dollar a soutenu
une croissance rapide des investissements directs du Canada à
l’étranger, ceux-ci s’élevant à
30 milliards. Il y a notamment eu un grand nombre de prises
de contrôle vers la fin de l’année.
Les échanges sur actions ont été inverses des
investissements directs. Alléché par la montée
boursière et l’appréciation du dollar au Canada,
l’étranger s’est procuré pour presque
13 milliards d’actions au pays après des délestages
l’année précédente. En revanche, le pays
a acheté en valeur nette pour seulement 4,3 milliards
d’actions étrangères, le moins en 13 ans.
Cette hésitation à se porter acquéreur d’actions
pourrait s’expliquer par des taux moindres de rendement imputables
au taux de change, mais la situation n’a pas empêché
les Canadiens de se procurer pour 8,2 milliards de dollars –
un record – d’obligations étrangères,
surtout aux États-Unis.
Marché du travail
Dans l’ensemble, la croissance de l’emploi est demeurée
stable à 2,2 % l’an dernier. Ce qui a le plus manifestement
marqué l’évolution de l’emploi l’an
dernier a été le marasme qui a régné
dans le secteur de la fabrication. L’emploi a accusé
sa première baisse importante depuis 1993 (il y a cependant
eu en 2001 un fléchissement ténu qui était
lié à l’effondrement du secteur des TIC). En
contrepoids, la demande s’est accélérée
à 2,8 % hors fabrication. Une vive demande intérieure
a soutenu une ferme progression dans les services et en construction,
alors qu’une industrie primaire en difficulté offrait
son premier gain appréciable depuis le milieu de la décennie 1980,
le plus grand depuis l’essor des cours des produits de base
en 1972 (figure 8). Il faut y voir l’effet de la vigueur de
la demande internationale qui s’attache à nos grands
produits primaires, ainsi que du rétablissement de l’activité
agricole après la sécheresse. Dans l’industrie
primaire, la production s’est redressée de 6 %
l’an dernier après avoir subi des pertes coup sur coup.
Figure 8

Un élément plus fondamental
d’évolution du marché du travail a été
une répartition plus égale de l’emploi et plus
particulièrement du chômage entre les groupes d’instruction.
Dans les années 1990, la progression de l’emploi
se trouvait largement infléchie en faveur du groupe des plus
instruits, et notamment des diplômés d’université.
Depuis l’an 2000, le taux annuel de croissance de l’emploi
est tombé de 6 % (années 1990) à
4 %10 dans le cas de ces diplômés
au moment où leur nombre s’accroissait largement. C’est
ainsi que la proportion de scolarisés universitaires ayant
un emploi a décru, passant de 78,4 % en 2000 à
76,1 %. C’est toujours plus que dans tout autre groupe,
mais cette diminution de 2,3 point contraste vivement avec
les augmentations qu’ont connues d’autres groupes, en
particulier les titulaires d’un diplôme ou d’un
certificat du palier postsecondaire, dont le taux d’emploi
de 73,5 % n’est maintenant inférieur que de 2,6 points
à celui des scolarisés universitaires, écart
le plus mince jamais constaté11.
Figure 9

La convergence des résultats sur le
marché du travail se remarquait d’emblée aux
taux de chômage. Depuis l’an 2000, le chômage
a plus monté chez les diplômés d’université
que dans tout autre groupe. Le taux est passé de 3,9 %
à 5,5 %, prenant sa deuxième valeur en importance
dans l’histoire (il avait culminé à 5,9 %
à la suite de la récession du début des années 1990).
Le chômage en hausse chez les diplômés d’université
s’explique par une prépondérance de l’offre
sur la demande. Le nombre de ces diplômés s’est
élevé plus rapidement que l’effectif de tout
autre secteur de la société. Avec un gain de 6,4 %
en 2003, le taux de progression s’est établi à
15 % dans l’ensemble depuis l’an 2000. Le
nombre de diplômés des universités canadiennes
a été stable à 175 000 environ ces dernières
années; c’est 5 % du contingent de ces diplômés
sur le marché du travail. Si cette partie de la population
active a augmenté plus vite que le nombre de diplômés
récents, c’est peut-être à cause des apports
d’immigrants ayant des titres universitaires (en 2001, 42 %
des intéressés étaient titulaires d’un
grade contre 19 % seulement en 1981)12.
L’offre globale de non-titulaires de grade universitaire s’est
accrue de 2 % seulement depuis l’an 2000; presque
tous étaient des scolarisés postsecondaires.
L’écart de taux de chômage entre titulaires et
non-titulaires de grade a rétréci à 2,7 points
l’an dernier, valeur la plus basse jamais relevée.
En 1992, il était de 6,7 points et, dans les années 1990,
il s’est établi en moyenne à 5,5 points.
Depuis le début de la décennie, la moyenne est tombée
à 3,2 points, ce qui est presque entièrement
dû à la montée du chômage chez les diplômés
d’université.
Les augmentations dans le cas des titulaires
d’un grade ou d’un certificat du palier postsecondaire
expliquent cette convergence des taux de chômage ces dernières
années. Au début de la décennie 1990,
les scolarisés universitaires avaient un taux de chômage
qui était de presque quatre points inférieur à
celui des titulaires d’un certificat ou d’un diplôme
postsecondaire. En 2003, l’écart entre les deux taux
en était à un minimum sans précédent
de moins d’un demi-point (5,5 % contre 5,9 %). C’est
là une tendance au plafonnement du chômage chez les
titulaires d’un certificat postsecondaire et à une
montée de ce même chômage chez les scolarisés
universitaires. Chez les premiers, le taux de chômage a été
stable à 6 % environ depuis trois ans, loin de sa valeur
de culmination de plus de 9 % au début des années 1990.
Contrairement à ce qui s’est passé chez les
diplômés d’université, cette stabilisation
a eu lieu malgré une constante progression du taux d’activité
de ce groupe, ce qui s’explique par une poussée de
l’emploi de 10 % chez les titulaires d’un certificat
ou d’un diplôme du palier postsecondaire. La montée
du chômage chez les diplômés d’université
s’est trouvée amortie par un ample fléchissement
de leur taux d’activité depuis cinq ans (2,3 points
au total). Cette situation est à comparer à l’élévation
des taux d’activité de tous les autres groupes d’instruction
depuis l’an 2000. Là encore, on constate l’inverse
des tendances des années 1990, époque où
les gens ayant fait moins que les études secondaires quittaient
le marché du travail à un rythme bien supérieur
au taux de passage à l’inactivité des groupes
d’instruction supérieure13.
Figure 10

Les raisons de ce retournement de situation de chômage sont
complexes chez les diplômés d’université
et dans les autres groupes d’instruction et pourraient traduire
davantage l’impact des phénomènes à court
terme comme l’éclatement de la bulle technologique
en 2000. Une explication partielle provient peut-être des
difficultés auxquelles se heurtent les immigrants récents
sur le marché du travail. Une autre explication serait l’évolution
de la demande selon les professions, le secteur des cols bleus ayant
été plus en croissance que le secteur des cols blancs
l’an dernier pour la première fois depuis 1997.
Ajoutons que la progression de 2,2 % de l’emploi dans
le premier de ces secteurs s’est opérée malgré
une contribution nulle des industries manufacturières, le
mouvement s’appuyant lourdement sur une pointe de croissance
ayant duré six ans dans l’industrie primaire et en
construction. Ces dernières années, un meilleur financement
des services de santé est aussi intervenu comme facteur,
la demande de techniciens ayant augmenté plus vite que la
demande de professionnels.
Figure 11

En revanche, le secteur des cols blancs a assisté à
un ralentissement de la croissance de l’emploi après
trois années consécutives de progression de 3 %
à la crête de la vague de la haute technologie de 1998
à 2000. Le taux de croissance y est tombé à
2 % depuis trois ans, mais il y a eu un gain de 1,8 %
en 2003. Le gros du ralentissement des trois dernières années
a eu lieu dans les professions de la gestion et des sciences naturelles
et appliquées, d’où l’idée que
l’évolution crête-creux de la haute technologie
a joué comme facteur premier dans ces secteurs professionnels.
De 1997 à 2000, l’emploi a fait un bond de 23 %
dans le domaine scientifique et de 5 % en gestion; depuis trois
ans, le taux de progression a diminué à 7 % dans
le premier cas et a véritablement chuté de 3 %
dans le second (malgré une légère remontée
l’an dernier).
Le résultat est que le taux de chômage est tombé
de 8,1 % à 7,7 % l’an dernier chez les cols
bleus et a monté à 4,5 % chez les cols blancs.
L’écart de 3,2 points des taux de chômage
entre cols blancs et cols bleus est le plus mince depuis 1989. Il
a culminé à 6,4 points en 1991 (où le
taux de chômage s’est envolé à 12,8 %
chez les cols bleus en période de récession) et oscillé
autour de 4 % depuis dix ans.
Figure 12

L’emploi était toujours en baisse dans l’ensemble
chez les gens ayant fait des études secondaires ou moins,
mais il y a aussi des éléments subtils d’évolution
qui sont dignes de mention. En particulier, l’emploi a un
peu augmenté une deuxième année de suite chez
les gens n’ayant pas fait d’études secondaires,
ce qui s’explique par la montée de l’emploi dans
l’industrie primaire (notamment en agriculture) et en construction.
La sécurité d’emploi a semblé s’améliorer
l’an dernier. Toute la progression de l’emploi a consisté
en un gain de 300 000 postes permanents, le meilleur depuis
l’an 2000. Par ailleurs, l’emploi temporaire a
marqué son premier recul (-32 000) depuis 1997. L’emploi occasionnel et saisonnier
a décru et le mouvement ascendant de l’emploi temporaire
a cessé, du moins temporairement.
Les travailleurs ont moins été menacés de licenciement.
Les licenciements à titre définitif ou provisoire
n’ont pas évolué après avoir augmenté
globalement de 152 000 les deux années précédentes.
Comme l’emploi a été en expansion dans l’ensemble,
l’implication est un taux de licenciement plus faible (autre
indice que l’arrêt de croissance du milieu de l’année
n’est pas à comparer à la récession du
début des années 1990, où près
de 1,5 million de travailleurs perdaient leur emploi chaque
année).
Le nombre de travailleurs qui ont quitté leur emploi (au
lieu de le perdre) a continué à croître constamment
au rebours même de ce qui s’était passé
dans la décennie 1990 où le nombre de démissionnaires
avait toujours été en décroissance (de 1990
à 1999). Depuis, il a augmenté de 21 % malgré
un marché du travail plus faible. Il ne semble y avoir aucune
raison particulière à cette tendance, puisqu’on
relève de fortes hausses pour les divers motifs de démission :
maladie, responsabilités familiales, retour aux études,
insatisfaction au travail (dans ce dernier cas, les démissionnaires
se sont faits plus nombreux d’année en année
depuis 1995, ce qui en a fait le motif le plus fréquent de
démission après le retour aux études).
Malgré une légère augmentation de leur taux
de chômage ces dernières années, un nombre croissant
de jeunes ont quitté leur emploi et sont passés à
l’inactivité, étant insatisfaits du dernier
emploi occupé. Depuis 1995, le nombre de jeunes démissionnaires
est passé de 32 000 à un sommet de 85 000,
rendant compte d’un peu plus de la moitié de la progression
observée dans cette catégorie (chez les hommes et
les femmes de plus de 25 ans, le nombre de démissionnaires
s’est accru de 24 000 dans les deux cas). Le retour aux
études n’a pas semblé un important facteur de
démission.
Salaires et prix
Avant 2002, le Canada a présenté un taux d’inflation
inférieur à celui des États-Unis huit ans de
suite. Cette année-là, le taux d’inflation canadien
a dépassé le taux américain. Il l’a fait
encore en 2003 malgré la forte montée du dollar canadien
vis-à-vis du dollar américain avec son éventuel
effet d’amortissement sur les prix canadiens par rapport aux
prix américains.
Cet effet ne s’est pas produit, ce à quoi on peut trouver
diverses explications. Le dollar américain n’a pas
été mis en dépréciation vis-à-vis
d’un certain nombre de monnaies asiatiques et, par conséquent,
il n’a décru que de 8,5 % l’an dernier en
pondération des échanges, haussant uniquement de 2,7 %
les prix à l’importation. Les importations rendent
compte à leur tour d’une proportion relativement faible
de 14 % de l’économie américaine.
Au Canada, l’IPC a été en hausse de 2,8 %
contre 2,2 % l’année précédente
en grande partie à cause du prix de l’énergie.
Les détaillants ont relevé leurs marges bénéficiaires
qui avaient été comprimées par la dépréciation
du dollar jusqu’en 2002; tant les marges que le dollar ont
atteint des sommets de dix ans. Ajoutons que le prix des cigarettes
a fait un bond de 16 % après un alourdissement de sa
taxation. Les prix de la plupart des autres biens ont décru
en partie par suite de baisses de prix à l’importation.
Les prix des biens durables ont diminué une quatrième
année de suite sous les effets combinés d’une
vive concurrence sur le marché de l’automobile et d’une
descente toujours rapide du prix des ordinateurs en puissance. Les
prix des biens semi-durables ont également fléchi
et les prix des vêtements ont évolué en baisse
une deuxième année de suite. Ceux des aliments ont
été contenus par la baisse du prix de la viande de
bœuf à la suite du cas de maladie de la vache folle,
l’engouement rapide pour les aliments pauvres en hydrates
de carbone – avec pour conséquence une diminution
des prix des pâtes et du riz – et la réduction
des prix des fruits et des légumes importés.
En revanche, les prix des services ont augmenté de 3,6 %
malgré de fortes baisses dans une industrie touristique en
difficulté. Les primes d’assurance-automobile ont fait
un bond à deux chiffres et l’essor du marché
de l’habitation a poussé le prix du logement en hausse.
Les cours des produits de base ont connu une forte progression une
deuxième année de suite. Leur redressement a coïncidé
presque parfaitement avec l’entrée de la Chine dans
l’Organisation mondiale du commerce en décembre 2001.
L’industrialisation rapide de ce pays en a fait un grand consommateur
d’hydrocarbures et de matières industrielles.
Ces matières industrielles ont mené le mouvement des
prix après avoir été devancées pendant
deux ans par les aliments et l’énergie. Les cours des
métaux, plus particulièrement de l’or, du nickel
et du zinc, ont aussi été en tête, se situant
à leur plus haut niveau depuis des années. Le prix
de l’énergie, qui avait rapidement progressé
en 2002, a crû plus lentement en 2003, mais en demeurant deux
fois plus élevé qu’immédiatement après
les attentats de septembre 2001.
Les règlements salariaux ont vite suivi ce soudain infléchissement
des fortunes sectorielles. Après avoir prédominé
en 2002, les majorations salariales en fabrication sont tombées
à leur plus bas niveau (2,4 %) en six ans, la demande
marquant un net ralentissement. Ce sont le secteur public et l’industrie
primaire qui ont présenté les plus grandes augmentations
de salaire (3 % environ) après avoir été
à la traîne pendant le plus clair de la décennie
précédente. C’est en construction que les salaires
se sont le plus redressés. L’essor du marché
de l’habitation a en effet créé des pénuries
dans certains métiers.
Conclusion
Depuis le début du nouveau millénaire, plusieurs tendances
qui existent depuis longtemps dans notre économie se sont
inversées. Le taux d’épargne personnelle est
maintenant moins élevé au Canada qu’aux États-Unis
et les ménages se sont de plus en plus endettés pour
financer leurs achats, plus particulièrement sur le marché
de l’habitation. En partie à cause de cet investissement
accru dans le domaine du logement, l’infléchissement
à long terme du patrimoine des ménages en faveur des
avoirs financiers a pris fin depuis l’effondrement boursier
de l’an 2000. La détérioration des bilans
des ménages était le miroir de l’amélioration
de ceux du secteur des entreprises. La décennie avait commencé
par deux ans de décroissance des investissements après
le boom technologique. Aujourd’hui, des excédents financiers
records et des bilans largement bonifiés font que les entreprises
sont bien placées pour faire durer cette relance de leurs
immobilisations qui s’est amorcée l’an dernier
et qu’elles prévoient poursuivre en 2004.
Notre relation avec le reste du monde change également rapidement,
en partie modelée par le renversement de notre dollar. Le
commerce transfrontalier de biens s’est affaissé pour
une troisième année de suite malgré la croissance
rapide avec la Chine, tandis que les dépenses des voyageurs
au Canada ont baissé pour la première fois en quinze
ans. L’investissement direct au Canada était le plus
bas de la décennie, amorti par la hausse du dollar. La hausse
du taux de change explique en grande partie l’écart
entre les pertes dans la fabrication et l’accélération
hors fabrication.
Ailleurs, sur le marché du travail, certaines des tendances
les plus certaines des années 1990 se sont transformées
ces dernières années. La demande qui s’attache
aux titulaires d’un grade universitaire a ralenti au moment
même où l’offre de cette main-d’œuvre
s’accroissait. L’emploi s’est redressé
chez les autres travailleurs en partie par une solide progression
en construction et dans l’industrie primaire (celle-ci ayant
connu sa meilleure année en deux décennies grâce
à l’essor des cours des produits de base). C’est
ainsi que l’écart de taux de chômage entre titulaires
et non-titulaires d’un grade universitaire est tombé
à un minimum record. La convergence des résultats
sur le marché du travail se remarquait aussi à un
écart entre professions des cols bleus et des cols blancs
qui n’avait jamais été aussi petit en plus d’une
décennie.
Études spéciales récemment parues
* Analyse de conjoncture (613) 951-9162
ou oec@statcan.ca.
1. Voir China
competing in the Global Economy, W. Tseng et M. Rodlauer
(dir.), FMI, 2003.
2. Voir « The Hungry Dragon »,
p. 59-60, dans The Economist, 21 février 2004.
3. Les avoirs en dollars des banques centrales
asiatiques ont augmenté de presque 240 milliards de
dollars américains; en Chine, les changes détenus
ont atteint les 420 milliards en novembre et, au Japon, les
650 milliards en décembre, à en juger par le
document « Remarks by Chairman Alan Greenspan »
à l’Economic Club de New York le 2 mars 2004.
C’est aussi la possibilité pour les États-Unis
de financer relativement sans mal leur déficit au compte
courant.
4. P. 11, Banque du Canada,
Rapport sur la politique monétaire, octobre 2003.
5. Une augmentation du tourisme
intérieur a amorti l’effet de la diminution de 12 %
des dépenses de non-résidents d’après
le document Indicateurs nationaux du tourisme, quatrième
trimestre 2003, publication no 13-009 au catalogue.
6. P. 5, Banque du Canada,
Revue du système financier, juin 2003.
7. P. 11, ibid.
8. P. 21, US Federal
Reserve Board, Monetary Policy Report to the Congress, février 2004.
9. P. 29, Perspectives économiques
de l’OCDE, décembre 2002.
10. Fait intéressant, le ralentissement
a été des plus prononcés chez les titulaires
d’un grade universitaire, groupe qui avait pourtant mené
le mouvement avec un gain de 61 % dans les années 1990.
11. La baisse du taux d’emploi
chez les titulaires d’un grade s’est limitée
aux gens de 25 ans et plus avec des diminutions à peu
près égales chez les hommes (-3,5 points) et
les femmes
(-2,7 points). Les mouvements étaient cependant contradictoires
dans ces groupes d’âge. Chez les hommes, le recul se
remarquait autant chez les 25 à 44 ans (-2,9 points)
que chez les plus de 44 ans (-2,3). Chez les femmes toutefois,
le mouvement était des plus concentrés chez les 25
à 44 ans (-2,9 points), les 45 ans et plus n’ayant
vu leur taux d’emploi diminuer que de 0,4 point.
12. Extrait de la page 1, G. Picot,
« The Deteriorating Economic Welfare of Immigrants, and
Possible Causes », étude inédite, Direction
des études analytiques, Statistique Canada, 2004. L’auteur
(p. 17) constate que les gains des immigrants récents
ont décru et que les taux de faible revenu se sont élevés
dans ce groupe en partie à cause de la montée rapide
de la scolarisation chez les Canadiens.
13. Un examen plus détaillé
indique que, dans le groupe le plus instruit, le passage à
l’inactivité a surtout eu lieu chez les femmes de 25
à 44 ans, dont le taux d’activité a diminué
de 1,5 point depuis cinq ans. Ce mouvement contraste vivement
avec la montée (près de 2 points au total) de
l’activité dans tous les autres groupes d’instruction
féminins. Le recul s’observait particulièrement
chez les femmes titulaires d’un grade. Chez les titulaires
de grade, le passage à l’inactivité était
aussi évident chez les femmes plus âgées et
chez les hommes de plus de 25 ans (le phénomène
ne ressort pas autant chez les hommes dont l’activité
est en lente décroissance depuis des années dans la
plupart des groupes d’instruction).
|


































 Consulter la version la plus récente.
Consulter la version la plus récente.